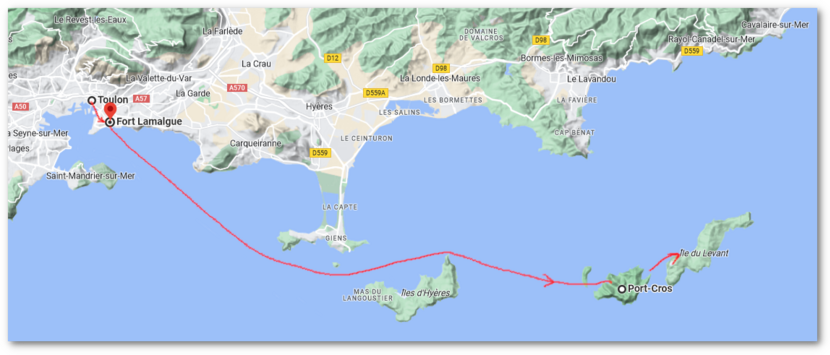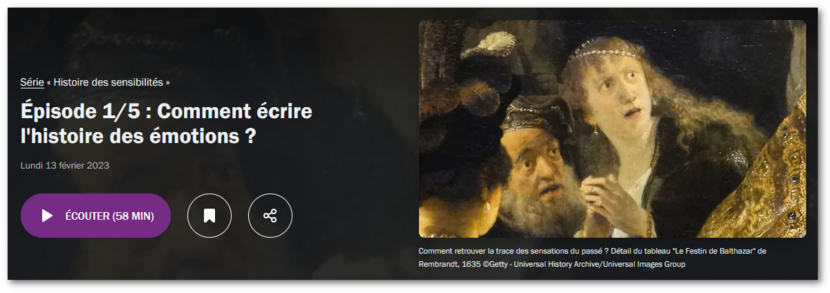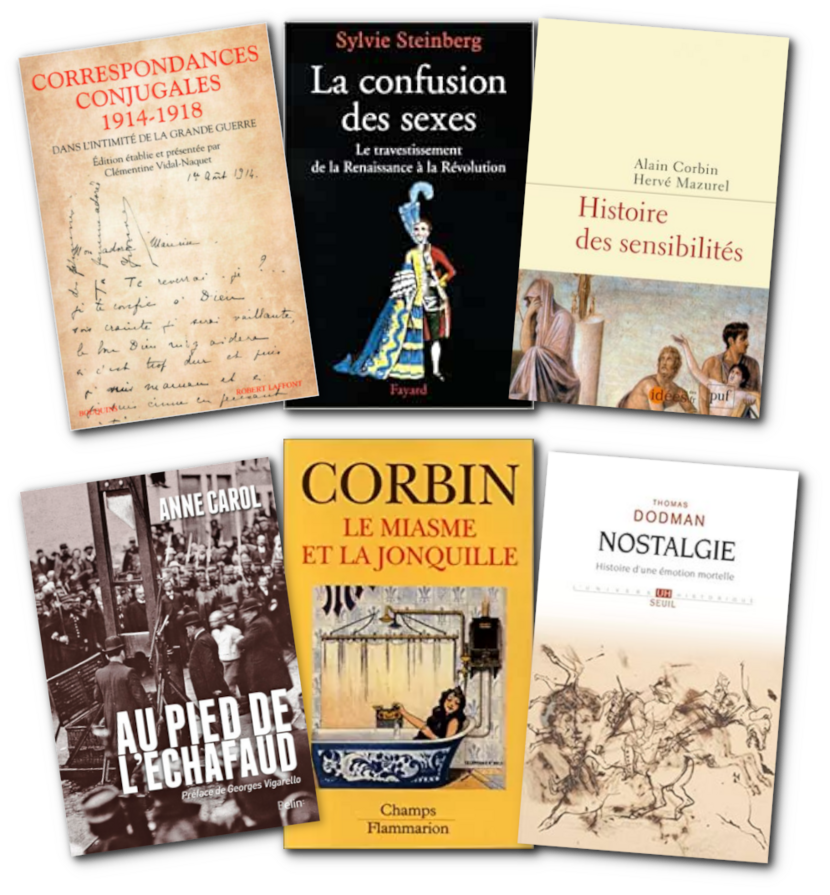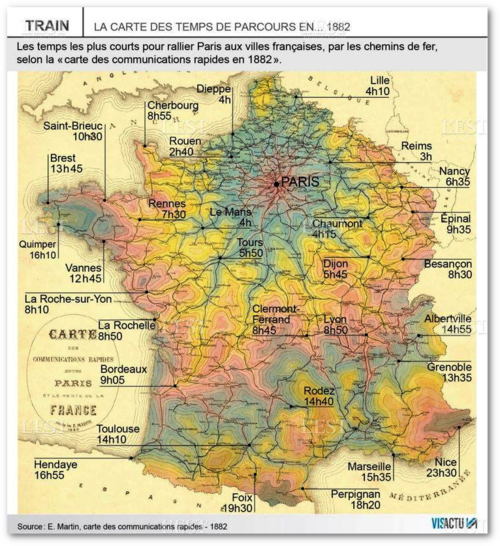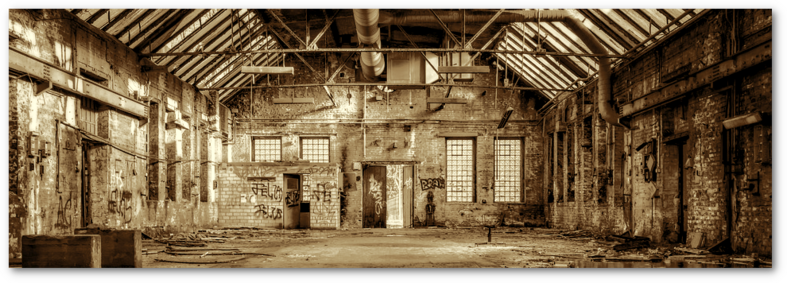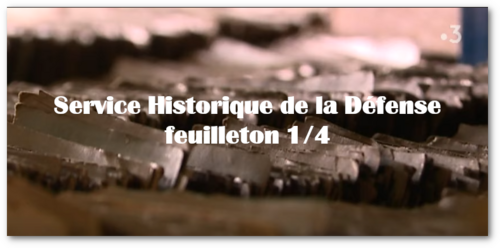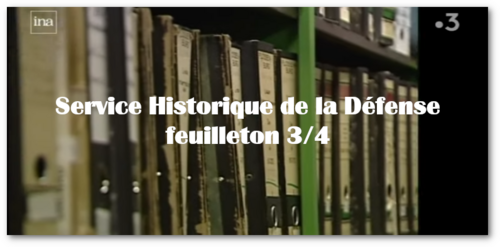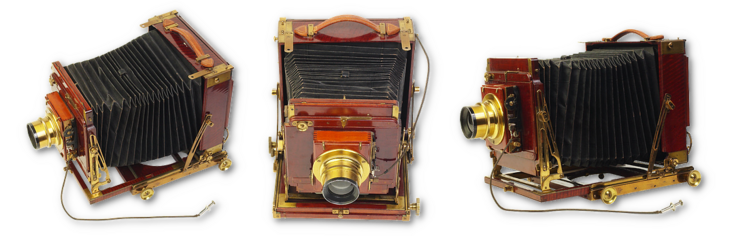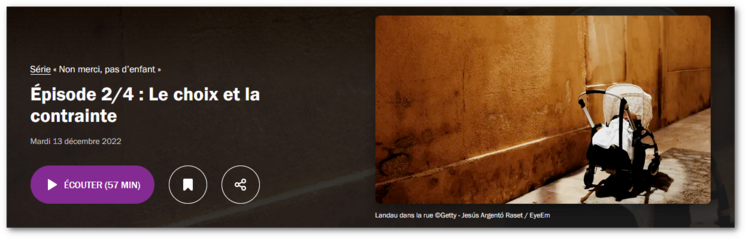-
Bibliographie & Filmographie
« Chercher ses racines, c'est au fond se chercher soi-même : qui suis-je ? Quels sont les ancêtres qui m'ont fait tel que je suis ? Des noms d'abord, des dates, quelques photos jaunies ou, avec plus de chance, un testament, une lettre. »
Claude LEVI-STRAUSS
« Les gens s'intéressent à leur passé parce que la seule chose à laquelle ils peuvent se raccrocher aujourd'hui, c'est leur famille. Pas la famille nucléaire, qui est elle-même éclatée, mais leurs ancêtres, c'est-à-dire ce qui ne leur fera jamais défaut. Ils se raccrochent aux branches.... de leur arbre généalogique ».
Anne Ancelin-SCHUTENBERGER
-
Par FANNOU93 le 27 Mars 2024 à 11:54
 « Si les statistiques placent les Côtes-du-Nord parmi les départements français les moins confrontés au phénomène de l'abandon, il a néanmoins beaucoup préoccupé les autorités qui n'eurent de cesse, pendant tout le siècle, de vouloir l'éradiquer coûte que coûte. S'intéresser à l'abandon des enfants, c'est s'intéresser à la fois à l'histoire de l'enfance et à l'histoire des femmes, particulièrement les femmes seules, mais aussi, plus généralement, à l'histoire de la vie rurale dans un département fortement imprégné de catholicisme. Filles-mères rejetées, enfants abandonnés stigmatisés, la société toute entière est concernée par l'abandon. C'est aussi s'intéresser à la transition entre philanthropie et encadrement du service de l'assistance par l'Etat qui, sous la IIIe République, triomphe avec la création de l'Assistance publique.
« Si les statistiques placent les Côtes-du-Nord parmi les départements français les moins confrontés au phénomène de l'abandon, il a néanmoins beaucoup préoccupé les autorités qui n'eurent de cesse, pendant tout le siècle, de vouloir l'éradiquer coûte que coûte. S'intéresser à l'abandon des enfants, c'est s'intéresser à la fois à l'histoire de l'enfance et à l'histoire des femmes, particulièrement les femmes seules, mais aussi, plus généralement, à l'histoire de la vie rurale dans un département fortement imprégné de catholicisme. Filles-mères rejetées, enfants abandonnés stigmatisés, la société toute entière est concernée par l'abandon. C'est aussi s'intéresser à la transition entre philanthropie et encadrement du service de l'assistance par l'Etat qui, sous la IIIe République, triomphe avec la création de l'Assistance publique.Les limites chronologiques de cette étude se sont imposées au regard de la législation en vigueur concernant l'Assistance Publique, véritablement créée par le décret impérial du 19 janvier 1811 et qui prévoit l'anonymat de l'abandon. Décrié rapidement en raison de l'augmentation des expositions qu'il suscite, modifié à moult reprises, ce texte reste néanmoins en vigueur pendant tout le siècle, marquant profondément de son empreinte l'histoire des enfants abandonnés. Il sera relégué par la loi du 27 juin 1904.
Les séries X et H du dépôt des archives départementales des Côtes-d'Armor constituent le socle de cette recherche, permettant une plongée passionnante dans la vie des enfants abandonnés et de leurs mères, aux conditions de vie misérables. La richesse des sources permet, non seulement de suivre ces dernières à des moments-clefs de leur vie comme celui de l'abandon, mais également de brosser, à grands traits, leur quotidien avant et après l'abandon. Elle permet de surcroit de mettre en lumière le rôle inducteur de la société catholique de l'époque, intransigeante, qui juge et condamne toutes celles qui mettent au monde un enfant hors-mariage. Les sources abondent pour autant sur le parcours des enfants abandonnés, depuis leur arrivée à l'hospice jusqu'au moment où ils sont gagés. Même si tous ne peuvent être suivis individuellement, il est possible cependant de dépeindre assez précisément les grandes lignes de leurs premières années de vie. Souffrances, chagrins, humiliations, silences imposés surgissent alors sans surprise des sources, mais aussi sursauts de révolte, insubordinations et désertions. Plus rares, quelques moments de malice et de joie viennent égayer le tout, sur fonds de misère générale ».
*
Voici un livre incontournable pour mieux comprendre l’histoire des femmes qui ont abandonné leur(s) enfant(s) : pourquoi ? Comment ? Dans quel contexte ? Quelle époque ? Même si vous n’avez pas d’ancêtres en Bretagne, la démarche que l’auteure utilise est bien utile pour appréhender votre propre histoire.
Lorsque j’ai découvert dans l’arbre de ma famille que mon AAgrand-mère avait été abandonnée dans un tour, c'était comme si le temps s'était arrêté, me laissant seul face à une révélation inattendue et déchirante : un maillon oublié de notre lignée, ce n’était pas possible !
Je me suis retrouvée à explorer son destin : qui était-elle, cette enfant abandonnée, privée de l'amour et de la chaleur d'un foyer familial ? Quels tourments avaient assombri son existence, quelles larmes avaient baigné son visage innocent dans les nuits solitaires ? Qu’avait-elle vécu au fil des placements dans les fermes morvandelles ? Comment a t-elle pu se construire, devenir adulte et élever ses propres enfants. D’ailleurs dans toute son histoire, elle n’a eu étrangement que deux enfants ; il était pourtant courant dans les années 1880 n’avoir une multitude de bambins….
Si ce livre m’a beaucoup apportée, il faut avouer que je n’ai pu trouver la réponse à toutes mes questions ; mais je ne désespère jamais !
*
Née en 1962, Isabelle Le BOULANGER, est enseignante et chercheuse associée au Centre de recherche bretonne et celtique de l'université de Brest. Docteur en histoire contemporaine, ses études la portent en particulier sur l'histoire des femmes et des enfants.
*
Pour en savoir plus :
Isabelle LE BOULANGER (Wikipedia)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par FANNOU93 le 27 Mars 2024 à 10:27
 Nous sommes un lundi, un lundi qui débute comme tous les autres…. Comme tous les autres ? Pas tout-à-fait. Parce qu’après ce lundi 20 février 1933 : rien ne sera plus comme avant.
Nous sommes un lundi, un lundi qui débute comme tous les autres…. Comme tous les autres ? Pas tout-à-fait. Parce qu’après ce lundi 20 février 1933 : rien ne sera plus comme avant.Vingt-quatre hommes sortent de leurs berlines noires, « vingt-quatre pardessus noirs, marron ou cognac, vingt-quatre paires d’épaules rembourrées de laine, vingt-quatre costumes trois pièces, et le même nombre de pantalons à pince avec un large ourlet. Les ombres pénètrent le grand vestibule du palais du président de l’Assemblée ; mais bientôt, il n’y aura plus d’Assemblée, il n’y aura plus de président, il n’y aura même plus de Parlement, seulement un amas de décombres fumants. »
« les vingt-quatre sphinx » sont :
- Albert Vögler (1877-1945) industriel allemand et dirigeant de la société minière Forges et Mines Germano-luxembourgeoises, magnat de l'acier, fondateur en 1919 du Deutsche Volkspartei (DVP, réactionnaire), finance le parti nazi avant sa prise du pouvoir en 1933 ; notable du Troisième Reich ; se suicide lors de son effondrement,
- Gustav Krupp von Bohlen und Halbach (1870 – 1950) dirige l'entreprise Krupp jusqu'en 1943 ; il comptait parmi les 24 principaux accusés du procès de Nuremberg, la procédure engagée contre lui a cependant été suspendue pour des raisons de santé (sur la photo à gauche)
- Wilhlem von Opel (1871 – 1948) un des fondateurs du constructeur automobile allemand Opel, introduisant la chaîne de montage dans l'industrie automobile allemande ; il rejoint le parti nazi et en devient rapidement un partisan actif, apportant des contributions financières aux SS et recevant le titre de mécène ; en janvier 1947, il fut reconnu coupable par un tribunal de dénazification et dut payer une forte amende ; il mourut l'année suivante,
- Günther Quandt (1881 – 1954) industriel allemand dont la seconde femme Magda – dont il divorce en 1929 - épousera deux ans plus tard le militant nazi et futur ministre de la Propagande de Hitler, Joseph Goebbels ; il sera nommé chef de l'économie de l'armement,
- Friedrich Flick (1883 – 1972) industriel allemand, magnat de l'acier, bénéficie de l'expropriation des Juifs, et de l'exploitation des déportés dans les camps de concentration ; condamné à 7 ans de prison lors des procès de Nuremberg, il n’en fait que 3, puis redevient l'une des plus grandes fortunes mondiales,
- Ernest Tengelmann (1870 – 1954) directeur de mine, siégea au conseil d'administration des mines de charbon d'Essen ; directeur général et président du conseil d'administration d'Essener Steinkohlenbergwerke AG et président du conseil d'administration de Gelsenkirchener Bergwerks-AG ; avec Carl Hold et Gustav Knepper, il fut l'une des figures les plus influentes de l'exploitation minière de la Ruhr,
- Fritz Springorum (1886 – 1942) industriel et homme politique allemand, a occupé des postes de direction chez Hoesch Aktiengesellschaft pendant plus de deux décennies, président de « l'Association pour la protection des intérêts économiques communs en Rhénanie et en Westphalie », dite Association Langnam en raison de son nom long, membre de l' Association industrielle de la Ruhrlade, membre du Parti national populaire allemand (DNVP) national-conservateur et anti-républicain ; en tant que successeur d'Albert Vögler, il prend la présidence de l'Association des métallurgistes allemands (VDEh) en 1936, mais abandonne ce poste en 1939 pour cause de maladie,
- August Rosterg (1870 – 1945) industriel allemand, directeur général de Wintershall AG ; il a eu une influence significative sur l'exploitation minière allemande de la potasse,
- Karl Buren directeur général de Braunkohlen- und Brikettindustrie AG, membre du conseil d'administration de Deutschen Arbeitgeberverbände,
- Gunther Heubel (1871 – 1945) président de l'Association minière de Basse-Lusacen juillet 1933, il est nommé président de la « Deutscher Braunkohlen-Industrievere ; ein e.V. » et chef du groupe spécialisé en lignite ; il est membre du conseil de surveillance de « Braunkohle-Benzin AG » (BRABAG) depuis sa création en 1934 ; lorsque des soldats russes arrivent dans son jardin, il se suicide le 20 avril 1945 dans son ancienne résidence officielle à Annahütte,
- Georg von Schnitzler (1884 – 1962) en 1927, il supervisa la création d'un cartel franco-allemand de vente de teintures et, en 1932, il y ajouta des sociétés suisses et britanniques, membre du conseil d'IG Farben ; il rejoignit la Sturmabteilung (Storm Division) en 1934 et occupa finalement le grade de Hauptsturmführer ; il a été admis au parti nazi en 1937,
- Hugo Hermann Stinnes, membre du conseil d'administration du Reichsverband der Deutschen Industrie, membre du conseil de surveillance du Syndicat rhénan-westphalien du charbon
- Eduard Schulte (1891 – 1966) directeur général de Giesches Erben, Zink und Bergbaubetrieb, industriel allemand important et l'un des premiers à alerter les Alliés sur l'extermination systématique des Juifs dans l'Allemagne nazie et dans l'Europe occupée ; ill est reconnu Juste parmi les nations par le Yad Vashem,
- Ludwig von Winterfeld (1880 – 1956) entrepreneur allemand chez Siemens-Schuckertwerke et Siemens & Halske AG. membre du conseil d'administration de Siemens & Halske AG et Siemens-Schuckertwerke AG.
- Wolf-Dietrich von Witzleben (1886 – 1970) fils de Carl Ludwig von Witzleben (1853-1900), entrepreneur allemand ; jusqu'en 1966, il fut président du conseil de surveillance de Siemens & Halske AG et de Siemens-Schuckertwerke AG, les deux sociétés mères de ce qui deviendra plus tard le groupe Siemens.
- Wolfgang Reuter directeur général de Demag, président de Verband Deutscher
- August Diehn (1874 – 1942) membre du conseil d'administration de Wintershall AG. Après 1933, il devient membre du F-Kreis (organisation d'industriels qui conseillaient le ministère allemand de la Propagande) et chef de brigade SS . Il a été membre du Conseil général de l'économie et a occupé diverses fonctions au sein du conseil de surveillance,
- Erich Fickler (1874 – 1935 ) président du conseil d'administration et directeur général de Harpener mining AG , membre de la Ruhrlade et président du conseil de surveillance du syndicat charbonnier rhénan-westphalien ; il fut l’un des premiers financiers du parti nazi,
- Hans Loewenstein (1874 – 1959) fonctionnaire minier allemand, homme politique et délégué du Reichstag,
- Ludwig Grauert (1891 – 1964) avocat allemand qui fut secrétaire d' État au ministère de l'Intérieur prussien et du Reich dans l'Allemagne nazie et joua un rôle dans la rédaction du décret d'incendie du Reichstag . Il était également SS- Brigadeführer .
- Kurt Schmitt (1886- 1950) membre du CA d’Allianz, membre du parti nazi ; le 29 juin 1933, il est nommé ministre de l'Économie du Reich, remplaçant Alfred Hugenberg, puis nommé membre honoraire de la SS,
- Hjalmar Schacht (1877 - 1970) ancien président de la Reichsbank, membre du cercle Keppler, ministre des Finances et conseiller particulier d'Adolf Hitler depuis son accession au pouvoir jusqu'en 1943, promoteur de la politique économique mercantiliste de redressement de l'Allemagne à partir de 1933, il fut inculpé, puis acquitté par le Tribunal de Nuremberg,
- August von Finck (1898 – 1980) banquier et homme d'affaires allemand, il était le fils du banquier Vilhelm von Finck (1848-1924), fondateur du géant de l'assurance Allianz et de la banque privée Merck Finck & Co ; en raison de ses liens étroits avec le régime d' Adolf Hitler, il était surnommé « le banquier d'Hitler »
- Ernst Brandi (1875 – 1937) ingénieur minier allemand, directeur industriel et président de la Ruhrbergbau.
Le cigare à la bouche, ils attendent : « nous sommes au nirvana de l’industrie et de la finance. » Ils représentent Krupp, BASF, Bayer, Agfa, Opel, IG Farben, Siemens, Allianz, Telefunken…
Hermann GOERING (1893 - 1946), président du Reichtag, arrive, puis Hitler, le nouveau Chancelier. La réunion secrète pouvait commencer : « il fallait en finir avec un régime faible, éloigner la menace communiste, supprimer les syndicats et permettre à chaque patron d’être un Führer dans son entreprise. »
Son objectif ? Récolter des fonds pour le financement du parti nazi.
Voici un récit historique comme je les aime, court mais pointu, documenté et intense ; l’auteur Eric Vuillard nous entraîne dans les méandres de l'annexion autrichienne.
Les mécanismes semblent bien huilés ; on y rencontre Lord HALIFAX, chancelier de l’Echiquier, Kurt von Schuschnigg, le « petit dictateur autrichien », lâche et sans envergure, Arthur Seyss-Inquart et son ascension fulgurante de SS « Gruppenfuhrer », Joachim von Ribbentrop, ambassadeur de reich, puis ministre des Affaires Etrangères « remarqué par Adolf Hitler pour son aisance, son élégance old fashion et sa courtoisie, au milieu de ce qu’était le parti nazi, un ramassis de bandits et de criminels » mais aussi Dalladier ou Albert lebrun, président de la République Française, sans grand charisme semble t-il….
D’un ton sarcastique, l’auteur énonce les faits et même si un grain de sable dans la mécanique des panzers ridiculise quelque peu cette armée allemande, il en faudra beaucoup pour empêcher la machine infernale d’avancer ! L’Allemagne nazie a envahi l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Hongrie, la Norvège, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique, la France… sans oublier la Grèce, l’Albanie et bien d’autres encore.
On voulait nous faire croire que tout a débuté avec l'anschluss : et pourant, « juste avant l’Anschluss, il y eut plus de mille sept cent suicides en une semaine. Bientôt, annoncer un suicide dans la presse deviendra un acte de résistance. Quelques journalistes oseront encore écrire « décès subit » ; les représailles les feront vite taire. »
Les chapitres s’enchaînent rapidement au rythme d’une dévastation méphistique. Mais ce terrible raz-de-marée n’a pas été désastreux pour tous ; certains en ont tiré « quelques avantages »....
« La guerre a été rentable. Bayer afferme de la main d’oeuvre à Mauthausen, BMW embauchait à Dachau, à Papenburg, à Sachsenhausen, à Natzweiler-Stuthof et à Buchenwald. Daimler a Schirmek ; IG Farben recrutait à Dora-Mittelbaum, à Gross-Rosen, à Sachsenhausen, à Buchenwald, à Ravensbruck, à Mauthausen, et exploitait une usine gigantesque dans les camps d’Auschwitz : l’IG d’Auschwitz, qui en toute impudence figure sous ce nom dans l’organigramme de la firme. Agfa recrutait à Dachau. Schell à Neuengamme. Schneider à Buchewald. Telefunken à Gross-Rosen et Siemens à Buchenwald (…) tout le monde s’était jeté sur une main d’oeuvre si bon marché. (…)
Sur un arrivage de six cents déportés, en 1943, aux usines Krupp, il n’en restait un an plus tard que vingt. »
Je tourne la dernière page du livre et je me sens mal, très mal ; de la réunion d’industriels et financiers allemands, complices de la barbarie nazie - responsables mais pas coupables (?) - j’étais naïvement persuadée qu’ils avaient tous « payés ».
L'auteur nous ramène à la dure réalité : le bruit des bottes qui claquent sur les pavés n’est jamais bien loin. Gardons-nous des brutes mégalomanes qui sommeillent encore dans notre vie politico-économique.
*
Pour en savoir plus :
Allemagne : l'interminable chasse aux Nazis | Les débats de Débatdoc
Nazisme : l'extermination par le travail... | Les débats de Débatdoc
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par FANNOU93 le 24 Mars 2024 à 16:56
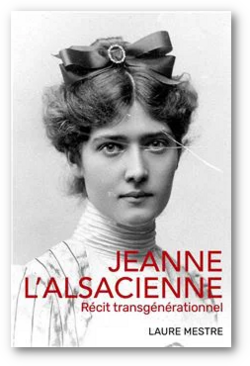 « Jeanne l’Alsacienne » est un livre auto-édité. Il a été publié par Laure MESTRE via la plateforme d’auto-édition Librinova. Diplômée en histoire du droit, de l’économie et de la société, l’auteure a fondé une agence de conseil en architecture intérieure et rédige depuis plus de dix ans le blog de décoration A tous les étages. Mais surtout, Laure MESTRE a élaboré et coanime le blog Généalogie Alsace, auquel je suis bien évidemment abonnée. Grace à ce récit transgénérationnel qui explore l’histoire de Jeanne, l’arrière-grand-mère maternelle de l’auteure, née à la fin du XIXème siècle en Alsace allemande, l’auteure se passionne désormais pour la psychogénéalogie.
« Jeanne l’Alsacienne » est un livre auto-édité. Il a été publié par Laure MESTRE via la plateforme d’auto-édition Librinova. Diplômée en histoire du droit, de l’économie et de la société, l’auteure a fondé une agence de conseil en architecture intérieure et rédige depuis plus de dix ans le blog de décoration A tous les étages. Mais surtout, Laure MESTRE a élaboré et coanime le blog Généalogie Alsace, auquel je suis bien évidemment abonnée. Grace à ce récit transgénérationnel qui explore l’histoire de Jeanne, l’arrière-grand-mère maternelle de l’auteure, née à la fin du XIXème siècle en Alsace allemande, l’auteure se passionne désormais pour la psychogénéalogie.*
Quatrième de couverture : « L'Alsace est opulence : fleurs en guirlandes aux balcons, lumière dorée sur les grappes sucrées, friandises à la cannelle, Noël toute l'année. Mais l'Alsace est une blessure insondable, une guerre fratricide, un élan lancinant qui me fend la poitrine. En moi, elle a laissé son empreinte. J'en viens, j'en suis, je ne peux lutter. L'Alsace me hante, me ronge et me réjouit à la fois. Je voudrais savoir pourquoi, je voudrais comprendre, chercher mes racines, puiser à la source. La mère de la mère de ma mère était alsacienne. Elle s'appelait Jeanne.
L’histoire de Jeanne, née allemande en 1880, dévoiel celle de l’Alsace tiraillée entre deux pays, celle d’une famille héritière de la source pétillante de Soultzmatt, celle des blessures et des secrets qui éclaboussent la descendance. Une enquête généalogique sur sept générations, de mères en filles : une quête de vérité, un retour aux sources, une invitation à découvrir que chacun porte en soi l’élan pour surmonter ses faiblesses. »
*
Dieu qu’elle est belle cette couverture, qu’il est doux au toucher ce livre : un hasard ou bien un appel à la démesure ?
Pas à pas, au fil des chapitres, je mesure le travail douloureux – oserai-je dire viscéral – que l’auteure a effectué. C’est d’ailleurs une démarche que chaque généalogiste entreprend, sans toujours savoir mettre un mot ou une phrase sur des sensations, des supputations, des questionnements, voire des interprétations. Ce travail est le fruit d’une enquête généalogique approfondie et d’un parcours expérimental qui corrobore les théories de psychogénéalogie et de mémoire corporelle.
Si vous vous attendez à lire une histoire romanesque et chronologique comme la plupart des écrivains savent les rédiger, passez votre chemin. Ce livre est une longue maturation, où avec force et douleur, l’auteure s’est « frayée un avenir dans les chemins creux congestionnés d’orties ».
Avec passion. Avec acharnement. Avec patience et pugnacité.

D’abord, le temps de l’introspection : « un travail de mémoire au sens propre. Laisser aussi l’Alsace imprégner mes cellules, capter mon attention, guider mon énergie. Aller plus loin que ce que seule la raison dévoile. ». Une introspection sans filtre – ou du moins j’ose le croire même si certains aspects ne doivent pas dévoiler un jardin trop secret.
Puis vient celui du dépouillement : « au-delà des détails, trouver la structure, l’armature, le squelette de l’arbre qui relie ses racines à ses rameaux ».
Enfin, l’enquête : « c’est à cette étape (…) que j’irai physiquement, charnellement à la rencontre de Jeanne. »
Et pour notre plus grand plaisir, arrive l’écriture. L’auteure a la « chance de disposer d’une iconographie fournie » ; la documentation est abondante et permet un récit rédigé avec sincérité, rigueur et émotion. Dresser le bilan des drames familiaux sur 7 générations de femmes n’est pas aisé mais Laure Mestre a la plume facile, le discours éloquent et le vocabulaire étoffé.
« Quelle est l’énigme à résoudre ? Comment faire décanter la boue, clarifier l’eau en même temps que la situation ? Comment fluidifier, faire circuler, désobstruer ? Redonner transparence, c’est voir le fond. »
Je ne sais pas si je suis très objective pour présenter ce livre, tant il m’a plu, tant il m’a fascinée, tant je me suis nourrie de cette rédaction, tant il a résonné en moi ; j’y voyais des balades au cœur des Vosges lorsqu’adolescente je passais mes vacances à Saint-Amarin ; je sentais l’odeur des sapins ; j’ai mesuré la douleur de mes ancêtres contraints d’abandonner leurs biens, la fierté d’une langue souvent malmenée et discréditée ; j’ai compris cette droiture que mon père m’imposait…
Inévitablement, cette lecture s’accompagne d’interpellations, d’énigmes non résolues, d’interrogations, mais jamais de jugement ; qui sommes-nous d’ailleurs pour nous permettre de juger nos ancêtres ; ils faisaient ce qu’ils pouvaient, avec leur âme et conscience… ou pas….
« Parce que je porte l’aveu et la réparation puisque je m’appelle Laure et non pas Cécile. (…) Parce que mon esprit de curiosité, d’intuition et d’ordre a fait de moi une apprentie généalogiste. Parce que je cherche sans cesse à comprendre, à déduire, à aimer : le transfert entre générations est un transport d’affection ».
L’auteure l’a bien compris et nous transmet un message : « connaître pour comprendre, comprendre pour transmettre, transmettre pour aimer ».
Bien sûr, ce livre ne s’est pas écrit sans douleurs ; et l’auteure confesse sereinement qu’Alix, somatothérapeute, l’a accompagnée tout au long de ce parcours éprouvant ; elle « accueille et apaise ma souffrance qui rejoint si souvent celle de ma mère, figée par le froid depuis son adolescence (….) Les frissons m’agitent : je dois me mettre en mouvement, je dois parler. »
Des naissances aux décès, des mariages aux migrations, chaque étape lui révèle une facette de son héritage, lui permettant de reconstituer le puzzle complexe de son histoire familiale. Il est des secrets que l’on ne peut taire….Au cœur de cette introspection réside la généalogie, une quête profonde pour comprendre, pour expliquer. Alors, au travers des archives poussiéreuses, des récits fabuleux et des dessins révélateurs, l’auteure découvre des visages oubliés, des noms gravés dans la pierre, des histoires transmises de génération en génération, et des secrets inavoués…
Chaque découverte est une révélation, quelquefois une indiscrétion, chaque nom une invitation à plonger plus profondément dans les méandres de son passé. Nous suivons avec elle les traces de ses ancêtres, illustres pour certains, parcourant des chemins de traverse pour d’autres. Mais qui leur en voudrait….
*
Pour en savoir plus :
Histoire des Sources de Soultzmatt (Site officiel des Eaux des Sources de Soultzmatt)
Traumatismes en héritage (Isabelle MANSUY)
Histoire d’une foi (Véronique Belem)
 2 commentaires
2 commentaires
-
Par FANNOU93 le 28 Février 2024 à 21:20
 Elle est princesse de sang, Fille de France, sœur du Roi Louis XVI, et catholique.
Elle est princesse de sang, Fille de France, sœur du Roi Louis XVI, et catholique. Il est roturier, botaniste du jardin du Roy, apothicaire, adepte des Lumières et protestant.
Tout oppose Madame Elisabeth et François Dassy. Pourtant, lorsqu'ils se rencontrent par hasard dans la forêt de Fontainebleau, une irrésistible attirance les pousse l'un vers l'autre. Mais la Révolution gronde et menace cet amour platonique et clandestin...
Voici toutefois un joli roman historique, facile à lire, distrayant, même si quelquefois madame Elisabeth énerve un tantinet… Il ne faut pas oublier le contexte : une « demoiselle » de sang royal se doit de faire respecter l’étiquette ; de surcroît, les femmes du XVIIIème siècle n’avaient la liberté des femmes d’aujourd’hui. Heureusement que les temps ont changé… même si les changement sont longs à venir et surtout jamais pérennes.
Si l’auteure s’est permise quelques libertés avec l’histoire de monsieur Dassy dont il reste peu de trace dans les archives, les faits relatifs à la situation de madame Elisabeth sont bien véridiques.
Au fil des pages, on rencontre le médecin genevois Théodore Tronchin, le naturaliste académicien Georges-Louis Leclerc de Buffon, le docteur-régent de la Faculté de médecine de Paris Félix Vicq d'Azyr ou bien encore André Thouin, fils du jardinier du roi.
On y croise également Benjamin Franklin, tout en faisant référence au très célèbre Carl von Linné et sa classification.
*
Pour en savoir plus :
Archives Tronchin du Musée historique de la Réformation
Jardin potager historique - Château de Prangins
Georges Louis Leclerc, comte de Buffon (Classe BnF)
Mais qui était Buffon ? (France Culture)
Buffon : naturaliste, botaniste et « Pline français » fuyant Paris pour la campagne (La France Pittoresque)
Linné françois ou Tableau du règne végétal.... auquel on a joint L'éloge historique de Linné (Gallica)
Philosophie botanique de Charles Linné (Gallica)
Jardin Chinois de M. Tronchin à Chaillot ; Plan du jardin de M. le comte d'Orsay (Gallica)
Lettres écrites de la campagne de Jean Robert Tronchin (Gallica)
Le Domaine de Madame Elisabeth
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par FANNOU93 le 15 Janvier 2024 à 17:58
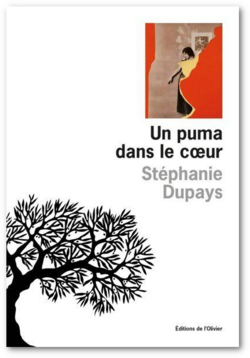 «Morte de chagrin, le cœur brisé.» Aux dires de la légende familiale, Anne Décimus, l’arrière-grand-mère de la narratrice, aurait suivi de près son mari dans la mort, laissant orphelines deux petites filles : l'une internée dans une maison de redressement et l'autre — la grand-mère de l'auteure — confiée à un orphelinat. Mais face aux silences de son entourage, Stéphanie Dupays décide de mener l’enquête.
«Morte de chagrin, le cœur brisé.» Aux dires de la légende familiale, Anne Décimus, l’arrière-grand-mère de la narratrice, aurait suivi de près son mari dans la mort, laissant orphelines deux petites filles : l'une internée dans une maison de redressement et l'autre — la grand-mère de l'auteure — confiée à un orphelinat. Mais face aux silences de son entourage, Stéphanie Dupays décide de mener l’enquête.Nous voici donc embarqués au cœur d’un secret de famille ; une simple recherche sur internet, et c’est la suspicion assurée ! Car Anne Décimus est décédée en 1964 ; son adresse était alors celle d’un asile d'aliénés dans la région bordelaise. Il n’y a plus aucun doute possible puisque la date d’entrée de son Agrand-mère à l’asile Chateau-Picon, le 10 septembre 1926, coincide avec l’accueil à l’orphelinat de sa grand-mère.
Stéphanie Dupays se plonge alors dans les archives : « il y a de quoi se perdre dans cette jungle de papier et oublier l’existence de l’extérieur, du grand air et de la lumière. Chaque boite ouverte contient l’espoir qu’elle me délivrerait des faits, des dates, des explications que je n’ai pas obtenus des vivants.»
Mais il lui faudra faire appel à quelques « connaissances » bien placées pour accéder au « Registre des aliénés placés volontairement et d’office » dans l’asile de Bordeaux, aux notes des aliénistes, et surtout aux lettres adressées par Anne aux psychiatres.
Ce récit est merveilleusement bien documenté sur la vie des malades, le quotidien de l'asile, les terribles restrictions alimentaires qui ont touché l'institution psychiatrique durant la dernière guerre (encore un tabou !), les traitements archaïques d’un autre temps : enfermement, contention, douches, traitements de choc, que son aïeule a vraisemblablement subis…..
La narratrice passe en revue l’histoire de la psychiatrie, en revisitant les écrits de Nelly Bly et Albert Londres, en citant quelques passages d’auteurs célèbres et de médecins avant-gardistes :
« Adoucissons leur sort, traitons avec bonté
Ces malheureux bannis de la société
Par de rude traitements, ne les effarouchons pas
Que des objets riants ne montrent sur leurs pas
C’est par ces quelques vers que commence la thèse d’Esquirol ».
Elle n’en oublie pas moins les nouvelles technologies et recherches d’aujourd’hui : « L’épigénétique a montré que les épreuves, les chocs, les deuils qu’ont vécus nos ancêtres ne se lèguent pas seulement par le climat familial ou la fréquentation des personnes mais marquent le patrimoine génétique qui se transmet de génération en génération. »
C’est une magnifique quête des origines, un cheminement intime vers la compréhension des malentendus et des non-dits qui dérangent. Nous avons tous dans nos familles des ancêtres oubliés, gommés des mémoires parce que leur existence contrarie et embarrasse.

Stéphanie Dupays replace son arrière-grand-mère une voix à une femme extraordinaire qui ne savait pas comment supporter le monde et qu’on a réduite au silence. Elle prouve que la littérature peut apaiser les fantômes.
Anne Decimus est donc morte de chagrin ? « C’est la meilleure version de l’histoire, celle qui a le pouvoir de réparer tous les dégâts. Chacun s’arrange comme il peut avec la souffrance. »
….. mais quelquefois, « on écrit pour admettre qu’il y a des choses que l’on ne peut connaître.»
*
Née en 1978 à Bègles – petite commune de la banlieue bordelaise - Stéphanie Dupays, est une écrivaine, haute-fonctionnaire et critique littéraire française. Ancienne étudiante de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique Inspectrice de l'Inspection générale des affaires sociales, elle a déjà publié
-
deux romans au Mercure de France :
-
Brillante en 2016 (prix Charles-Exbrayat)
-
Comme elle l’imagine en 2019
-
-
des ouvrages collectifs et essais
-
Le Goût de la cuisine en 2015
-
Déchiffrer les statistiques économiques et sociales en 2008
-
Politiques sociales en 2011
-
*
L’asile public des aliénées de Bordeaux : hygiénisme en psychiatrie et rationalisme architectural (Persée)
L’asile des femmes aliénées de Bordeaux (Gallica)
Centre hospitalier spécialisé Charles-Perrens (Wikipedia)
Histoire de la psychiatrie en France (Michel Caire)
10 jour dans un asile de Nelly Bly
 votre commentaire
votre commentaire
-
-
Par FANNOU93 le 13 Janvier 2024 à 21:02
 Quatrième de couverture : « Dans les années 1860, Londres, le coeur de l'empire le plus puissant du monde, se gave en avalant les faibles. Ses rues entent la misère, l'insurrection et l'opium. Dans les faubourgs de la ville, un bâtard est recueilli par Charlotte, une Irlandaise qui a fui la famine. Par amour pour lui, elle va voler, mentir, se prostituer sans jamais révéler le mystère de sa naissance.
Quatrième de couverture : « Dans les années 1860, Londres, le coeur de l'empire le plus puissant du monde, se gave en avalant les faibles. Ses rues entent la misère, l'insurrection et l'opium. Dans les faubourgs de la ville, un bâtard est recueilli par Charlotte, une Irlandaise qui a fui la famine. Par amour pour lui, elle va voler, mentir, se prostituer sans jamais révéler le mystère de sa naissance.
L'enfant illégitime est le fils caché d'un homme célèbre que poursuivent toutes les polices d'Europe. Il s'appelle Freddy et son père est Karl Marx. Alors que Marx se contente de théoriser la Révolution dans les livres, Freddy prend les armes avec les opprimés d'Irlande ».L’auteur, Sébastien Spitzer, redonne vie à des personnages disparus en nous plongeant dans leur quotidien, de Karl Marx, le Maure, à Friedrich Engels, le riche industriel qui pouvait pratiquer la chasse à courre avec des lords puis pousser ses ouvrières à se révolter tout en les traitant bien mieux que tous ses collègues en passant par Charlotte, la petite irlandaise, un personnage fictif attachant, qui donnerait sa vie pour sauver Freddy.
Capitale en pleine ébullition industrielle, « Londres est la ville-monde immonde. Ses rues sentent l’exil et la suie, le curry, le safran, le houblon, le vinaigre et l’opium. La plus grande ville du monde est une Babylone à bout, traversée de mille langues, repue de tout ce que l’Empire ne peut plus absorber. Elle a le cœur des Tudors et se gave en avalant les faibles. Et quand elle n’en peut plus, elle les vomi au loin et les laisse s’entasser dans ses faubourgs sinistres. »
C’est une fresque historique et sociale pleine de vigueur d’une ville où tout peut arriver...
Ce Londres du XIXe siècle si bien décrit dans ce livre comme l'avait fait auparavant Charles Dickens.Mais après la lecture de ce livre, vous ne verrez plus Karl Marx de la même façon….
*
Pour en savoir plus :
Karl Marx (Le Maitron)
ENGELS Friedrich (Le Maitron)
"La lutte des classes avec Marx et Engels" (France Culture)
Toute sa vie, Marx s'est battu pour la cause des ouvriers
l'Archive Internet des Marxistes
Généalogie de Karl MARX (Geneastar)
Friedrich ENGELS (Geneanet)
Karl Marx, penseur contemporain (INA)
Karl Marx, le combattant (France Culture)
Dans la peau de Karl Marx (France Culture)
L'histoire sociale de Londres au XIXe siècle. Sources et problèmes (Persée)
Le capital / par Karl Marx (Gallica)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par FANNOU93 le 8 Décembre 2023 à 17:59
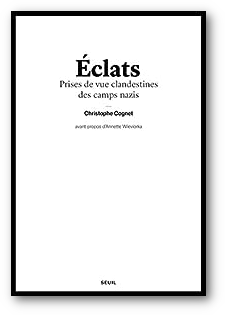 « À partir d'un corpus pour partie inédit, Christophe Cognet enquête sur les photographies clandestines des camps nazis, comme autant d'actes de résistance. Depuis plus de quinze ans, Christophe Cognet mène une méditation, filmique, sur les images réalisées par les déportés eux-mêmes, en secret, et au risque de leur vie, dans les camps nazis. Après « Parce que j'étais peintre », sorti en salles en 2014, consacré aux dessins et aquarelles, il travaille désormais à un autre film, À pas aveugles, à la rencontre de telles photographies : à Auschwitz-Birkenau et à Buchenwald, Dachau, Mittelbau-Dora et Ravensbrück, des détenus ont réussi à prendre des clichés clandestins.
« À partir d'un corpus pour partie inédit, Christophe Cognet enquête sur les photographies clandestines des camps nazis, comme autant d'actes de résistance. Depuis plus de quinze ans, Christophe Cognet mène une méditation, filmique, sur les images réalisées par les déportés eux-mêmes, en secret, et au risque de leur vie, dans les camps nazis. Après « Parce que j'étais peintre », sorti en salles en 2014, consacré aux dessins et aquarelles, il travaille désormais à un autre film, À pas aveugles, à la rencontre de telles photographies : à Auschwitz-Birkenau et à Buchenwald, Dachau, Mittelbau-Dora et Ravensbrück, des détenus ont réussi à prendre des clichés clandestins.
Ce second volet compose une archéologie des images en tant qu'actes, insistant sur leurs dimensions physiques - c'est ce que peut le cinéma. Le livre Éclats - au sens d'esquilles, de brisures - est issu autant de ce projet de film que de cette longue fréquentation des images clandestines : il compose l'aventure d'un regard en proposant des analyses sensibles de ces photographies, toutes scrutées longuement, puis remises dans leurs contextes.
Il s'agit de reprendre l'enquête - et parfois de l'initier - avec le savoir disponible aujourd'hui, sans théorie, mais sans ignorer toute théorie, sans préjuger de ce que ces images ont à nous montrer et à nous dire. Il s'agit tout autant d'une exploration historique que de faire l'éloge de leurs auteurs, les remettre au centre et à l'origine de leurs images. Ce livre veut ainsi composer le récit très précis de leurs actes et des scènes prises, mais aussi former les portraits, lorsque c'est possible, tant des femmes et des hommes photographes que de ceux représentés ».Que dire de ce livre ? Peu de photos, mais beaucoup d’explications, de technique, de regards, car ces hommes et ces femmes ont pris des risques inouïs, souvent au péril de leur vie, pour, témoigner de leur vécu, de la haine, de leurs humiliations, comme un acte de résistance.
Né à Marseille en 1966, Christophe Cognet est scénariste et réalisateur. Attentifs aux traces et au travail de la mémoire, ses films interrogent le cinéma, les formes de pouvoir et de surveillance, les mécanismes de la création et la puissance des images.
*
Pour en savoir plus :
Citéphilo 2020/Institut pour la Photographie - Éclats. Prises de vue des camps nazis
Histoire: Annette Wieviorka recoit Christophe Cognet sur RCJ
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par FANNOU93 le 12 Octobre 2023 à 11:51
 Lodz 1939. Pologne. L'histoire de deux femmes, une juive et une polonaise, soupçonnée de résistance.
Lodz 1939. Pologne. L'histoire de deux femmes, une juive et une polonaise, soupçonnée de résistance.Quatrième de couverture : « Lorsqu'elle arrive à Auschwitz, sous un ciel bas et gris, Ana est persuadée qu'elle ne survivra pas à l'enfer du camp. Mais elle possède une compétence que les nazis recherchent : elle est sage-femme. Son travail sera de donner naissance aux enfants des autres prisonnières. Une mission terrible car, dès qu'ils ont poussé leur premier cri, les nouveau-nés sont arrachés à leurs mères et donnés à des familles allemandes. Malgré la détresse de ces femmes à qui on vole leurs bébés, Ana essaie d'apporter un peu de réconfort autour d'elle. Et puis un jour, elle réalise qu'elle peut faire plus. Secrètement, elle commence à tatouer les petits avec les numéros de déportées de leurs mères. Une lueur d'espoir dans ce monde d'une infinie noirceur : et si un jour, après l'horreur de la guerre, grâce à ce petit geste, ces enfants et leurs mères pouvaient se retrouver ? »
*
Cœur sensible, s’abstenir. Je peux dire que j’ai lu de nombreux livres – romans et témoignages – mais j’avoue que l’auteure a fait fort…. Ce roman vous prend aux tripes.
Malgré tout, je l’ai lu jusqu’au bout, même si quelquefois, je l’ai abandonné pour le reprendre ensuite : j’avais besoin de savoir ce que ces enfants devenaient...
Certes, ce livre est un roman, mais il est tiré de faits réels, c’est peut-être pour cette raison que je me suis imposée cette lecture difficile : des scènes insoutenables, des situations épouvantables mais malgré tout, l’amour et l’amitié.
Deux femmes qui se soutiennent mutuellement : « Je suis là et je ne te lâcherai pas. Rappelle-toi : notre seule arme, c’est de rester en vie, et pour rester en vie, nous devons aimer, nous devons donner, et malheureusement, nous devons souffrir. »
Un livre important pour le devoir de mémoire ; l’auteure s’est inspirée de personnages ayant véritablement existés et de situations réelles :
- Stanislawa Leszczynska, sage femme à Lodz puis à Auschwitz
- Joseph Mengele, médecin tristement célèbre pour des « expériences » qui n’ont rien à voir avec la science,
- Mala Zimetbaum, linguiste de talent, interprete et messagère à Auschwitz,
- Les trains, les convois et leur signification historique
- Le sapin de Noël à Auschwitz ou les marches de la mort,
- L’insurrection à Varsovie, la résistance intérieure polonaise
- et le programme Lebensborn, « pouponnière du IIIème Reich ».
Anna STUART est une romancière britannique. Elle est l’auteur de plusieurs romans qui se déroulent pendant la Seconde Guerre Mondiale ainsi que des sages médiéviales. Ses livres, devenus des best-sellers, sont traduits dans une dizaine de langues.
*
Pour en savoir plus :
Chelmno-Kulmhof (Encyclopédie multimedia de la Shoah)
« Les Petits Héros du ghetto de Varsovie » (Le Monde)
Concentrer et enfermer : la politique des ghettos (Le Mémorial de la Shoah)
Auschwitz: Révélant les Horreurs et les Expériences Humaines
Transmission avec une survivante des camps
Témoignage : Otto Klein, l'un des jumeaux cobayes du docteur Mengele
Enfants cachés : à la recherche des familles
Le CICR durant la Seconde Guerre mondiale : face à l'Holocauste (Comité International de la Croix Rouge)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par FANNOU93 le 25 Septembre 2023 à 06:24
 Une lecture, intéressante, qui amène à la réflexion.....
Une lecture, intéressante, qui amène à la réflexion.....Quatrième de couverture : « Ma famille maternelle a quitté la Roumanie communiste en 1961. On pourrait la dire "immigrée" ou "réfugiée" . Mais ce serait ignorer la vérité sur son départ d'un pays dont nul n'était censé pouvoir s'échapper. Ma mère, ma tante, mes grands-parents et mon arrière-grand-mère ont été "exportés" . Tels des marchandises, ils ont été évalués, monnayés, vendus à l'étranger. Comment, en plein coeur de l'Europe, des êtres humains ont-ils pu faire l'objet d'un tel trafic ? Les archives des services secrets roumains révèlent l'innommable : la situation de ceux que le régime communiste ne nommait pas et que, dans ma famille, on ne nommait plus, les juifs.
Moi qui suis née en France, j'ai voulu retourner de l'autre côté du rideau de fer. Comprendre qui nous étions, reconstituer les souvenirs d'une dynastie prestigieuse, la féroce déchéance de membres influents du Parti, le rôle d'un obscur passeur, les brûlures d'un exil forcé. Combler les blancs laissés par mes grands-parents et par un pays tout entier face à son passé ».L’auteur, Sonia DEVILLIERS, est journaliste et anime quotidiennement une émisson de radio sur France Inter. Ce récit est son premier livre ; il est percutant, cru, et certains passages sont difficiles à lire tant l'inhumanité infligée aux juifs est insoutenable, mais indispensables à la mémoire collective. Il se veut un témoignage historique de la Roumanie de l'après-guerre, une Roumanie au passé fasciste et antisémite, qui rivalise d’horreurs avec les tortionnaires de l’Allemagne nazie.
Sonia DEVILLERS ne sait pas grand-chose de sa famille, alors comme bon nombre de généalogistes, elle part à la découverte de son histoire, en posant des questions, en fouillant les archives. Et ce qu’elle va y découvrir, c’est l’Histoire : la persécutions de ses grands-parents Harry et Gabriela, membres importants du Parti communiste roumain, la fierté d’être juifs et d’avoir réussis à s’en sortir. Elle mène l’enquête et déroule l’histoire familiale chronologiquement ; mais ne vous y trompez pas, ce livre, à mon sens, ne se lit pas comme un roman : il est violent, lucide et fait de nombreuses références à l’histoire de la Roumanie, un pays dont je ne connaissais pas en détail les horreurs d’un régime totalitaire.
*
Pour en savoir plus :
Bucarest : le petit Paris des Balkans (France Bleu)
Histoire de la Roumanie pendant la Seconde Guerre mondiale (Wikipedia)
L’oiseau dans son nid : le communisme en Roumanie (Cairn)
La rhétorique antisémite du régime d’Antonescu (Cairn)
L’oubli du fascisme roumain (Cairn)
Les images du pogrom de Bucarest (21-23 janvier 1941) (Cairn)
La Roumanie (Encyclopédie multimedia de la Shoa)
Recherche généalogie en Roumanie (Ancestry)
Généalogie Roumanie (Archives en ligne)
Retrouver ses ancêtres en Roumanie (Geneanet)
Faire des recherches généalogiques en Roumanie (Ons-aïeux)
Bucarest-Moscou : le ferment nationaliste des dissensions bilatérales (1964) (Cairn)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par FANNOU93 le 1 Septembre 2023 à 13:34
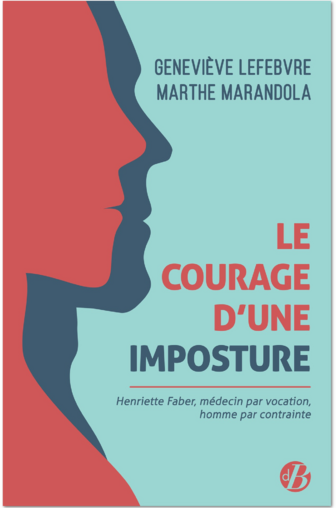 Est-elle réellement une « imposture » cette petite Henriette – ou Enriqua ou Henri ou Dr Faber - née à Lausanne vers 1791 ? Pour répondre à la question, il vous faudra lire ce roman historique, vrai, flamboyant, cruel mais vrai ; il est l’histoire véritable d’une femme qui refuse à se soumettre « à un homme, mari ou truand, de toute façon un maître »….
Est-elle réellement une « imposture » cette petite Henriette – ou Enriqua ou Henri ou Dr Faber - née à Lausanne vers 1791 ? Pour répondre à la question, il vous faudra lire ce roman historique, vrai, flamboyant, cruel mais vrai ; il est l’histoire véritable d’une femme qui refuse à se soumettre « à un homme, mari ou truand, de toute façon un maître »….Orpheline très jeune, Henriette suit les Campagnes napoléoniennes avec son oncle, colonel de la Grande Armée. Confrontée à l’horreur des innombrables blessés, elle se porte volontaire pour aider, écouter, soulager.
Très tôt, sa décision est prise, même si elle affectionne particulièrement la cantinière Marie-Tête-de-Bois : « elle sentait bon la pipe, le vin, l’eau-de-vie et Dieu sait quoi encore…. »
« Elle ne savait pas encore comment, mais il était hors de question de passer sa vie aux corvées. Un jour, elle aussi serait officier ! ».
C'est alors la naissance d'une vocation qui ne la quittera plus : soigner sans distinction de rang, nationalité, race, sexe. Mais, voilà, la médecine est interdite aux femmes et elle doit se métamorphoser en homme si elle veut réaliser son rêve.
« Henriette, face au miroir, prenant le temps de se contempler, cheveux coupés et mains sur les hanches, s’appropria résolument cette nouvelle image d’elle-même. Elle se sentit l’habiter avec une assurance et une satisfaction croissantes. Son visage était le même, pourtant, c’était Henri, sans aucun doute. Henri ! »
« En homme, tout ou presque était possible. Boire, chanter, mettre les pieds sur la table, se montrer insolent, rire à gorge déployée, user de mots de charretier. »
Officier courageux, il se lance dans l’aventure et devient disciple du grand Larrey, chirurgien en chef de la Garde Impériale. Le chemin est long, très long, mais Henri est déterminé et rien ne l’arrêtera.
« Des femmes combattantes dans la Grande Armée, il y en avait. Leur sexe était souvent découvert à l’occasion d’une blessure. D’autres étaient connues comme telles, leur état militaire étant la conséquence des armées de la Révolution. L’Empereur avait décoré plus d’une brave, ! On racontait leurs exploits. Mais pour Henri, la découverte de son genre aurait fermé à tout jamais les portes de la médecine. Il n’en était donc pas question. »
Ce livre est un hommage à une femme exceptionnelle, tour à tour médecin militaire et médecin des pauvres, ballottée d’une caserne à l’autre, prisonnière et exilée, sans jamais lâcher. De sa Suisse natale aux campagnes de Russie, puis d’Espagne à Cuba, Henriette Faber a vécu un destin exceptionnel, avec un regard précurseur tant sur la condition des femmes que sur la question de l'identité et du genre.
Il faudra d’ailleurs plusieurs siècles pour faire changer les mentalités, et encore ! Rien n’est jamais acquis…..
Ce roman historique est l’oeuvre de deux plumes : Geneviève LEFEBVRE, scénariste et cinéaste, et Marthe MARANDOL, journaliste scientifique. Elles sont associées et amies depuis longtemsp et oeuvrent dans le champ de la médiation. Autrices de plusieurs essais dont un primé (Prix Osiris du développement personnel), « L’intimité ou comment être vrai avec soi et l’autre », elles se sont passionnées pour cette héroïne, largement oubliée et pourtant extraordinairement contemporaine.
Pour en savoir plus :
Epidémies et campagne de Russie de 1812 (Histoire de la médecine)
Femmes en costume de bataille (Napoléon.org)
Baron Dominique-Jean LARREY (Portraits de médecins)
Mémoires du Baron Larrey, chirurgien sous Napoléon 1er (Mémoires des Hommes)
Dominique Larrey, le bienfaiteur mal connu (SFHAD)
Un chirurgien dans la débâcle de 1812 : Larrey, « Sisyphe philanthrope » ? (Cairn)
Dominique Jean Larrey (1766-1842), grande figure de la chirurgie de guerre (Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine)
Chirurgien en chef de la Grande Armée, Commandeur de la Légion d'Honneur, Baron de l'Empire (Napoléon et l’Empire)
Enriqueta Faber, insoumise et première femme médecin à Cuba (TV5 Monde)
Henriette Ou Enriqueta FABER ou FUENTEMAYOR (fiche Geneanet
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par FANNOU93 le 10 Août 2023 à 13:37
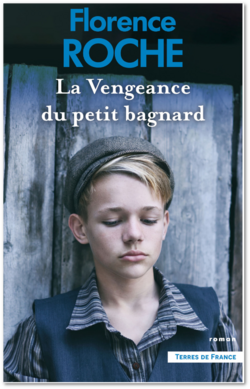 Quatrième de couverture : « Marius a juré de se venger des sévices endurés au cours des années passées dans le bagne pour enfants de l'île du Levant. Un drame familial doublé d'une énigme policière à suspense.
Quatrième de couverture : « Marius a juré de se venger des sévices endurés au cours des années passées dans le bagne pour enfants de l'île du Levant. Un drame familial doublé d'une énigme policière à suspense. Marius l'a reconnue aussitôt qu'il a posé le regard sur elle et humé son parfum : la tortionnaire de son enfance. Quatre années durant, alors qu'il était un très jeune détenu au bagne pour enfants que le Second Empire a créé sur l'île du Levant, il a subi des sévices sous le regard d'un mystérieux voyeur, et il en a gardé des cicatrices indélébiles, tant physiques que morales. Il a juré de découvrir l'identité du monstre. L'orphelin a grandi ; il est à présent l'homme de confi ance des puissantes filatures Redon, en Normandie, où l'ont mené ses premières investigations.
Un jour, le monstre est là, devant lui. L'heure de la vengeance a sonné. Mais ils sont nombreux autour de lui à avoir des raisons de vouloir la mort de cet abominable personnage.
Dans un suspense haletant, La Vengeance du petit bagnard mêle tragédie familiale, histoire d'amour et enquête policière à énigme ».
Voici donc un drame historique doublé d’une enquête policière ; l'auteure Florence Roche nous raconte l’histoire de Marius, âgé seulement de 10 ans, emprisonné dans la colonie pénitentiaire sur l'île du levant pour avoir volé de la nourriture et des médicaments pour sa mère. Suivront 4 années de sévices, qui marqueront à vie l’enfant puis l’homme qu’il va devenir. La vengeance ne le quittera jamais.
Ce roman est fluide, facile à lire, mais quelquefois un peu trop « fleur bleue » pour ma part.
*
Ce roman n’aurait pu être qu’une banale histoire à lire durant les vacances d’été. Seulement, voilà, j’ai voulu en savoir plus : est-ce que les personnages ont réellement existé ? Est ce que les lieux
 sont imaginaires ? Et puis, cet écrit est le reflet d’une société au XIXème siècle : précarité, vol, prostitution, patriarcat mais aussi la grande bourgeoisie et ses règles, sous peine d’exclusion.
sont imaginaires ? Et puis, cet écrit est le reflet d’une société au XIXème siècle : précarité, vol, prostitution, patriarcat mais aussi la grande bourgeoisie et ses règles, sous peine d’exclusion.Si certains personnages sont totalement fictifs, d’autres font une brève apparition et sont des personnes authentiques, et que dire des lieux…..
Qu’il s’agisse du bagne de l’Ile du Levant ou bien de la grande filature en Normandie, tout est malheureusement bien réel.
*
Pour en savoir plus :
A la découverte du fort Lamalgue (Les enfants du patrimoine)
L'Ile du Levant et les bagnes pour enfants (Greffier noir)
Le maquisat des iles d’or (Gallica P 252-266)
Monographie des Îles d'Or, presqu'île de Giens, Porquerolles, Port-Cros, île du Levant (Gallica – Ile du Levant P153)
Fortifications. Isles d'Hyères. 1783. Plan de l'Isle du Levant (Gallica)
Affaire de la révolte au pénitencier de l'île du Levant (Gallica)
https://filaturelevavasseur.fr/ (visite virtuelle)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par FANNOU93 le 14 Juillet 2023 à 11:30
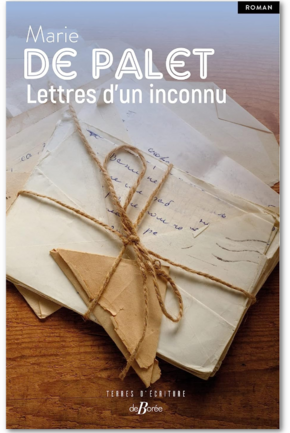 « Un jour de pluie et d'ennui, le jeune Paul, fils de paysans lozériens, trouve au grenier un petit tas de lettres adressées à une certaine Marie, prénom porté par sa mère. Mais qui est ce Marcel qui lui a écrit autrefois et dont Paul n'a jamais entendu parler ? Aidé de son frère Louis, il décide de retrouver la trace de ce mystérieux expéditeur. Les années passent et Paul s'éloigne vers la capitale où un travail l'attend tandis que Louis reprend l'exploitation familiale. Les moments partagés, désormais bien rares, les ramènent toujours vers leurs recherches. Leur persévérance finira-t-elle par porter ses fruits ? Quels secrets de famille les deux frères exhumeront-ils ? »
« Un jour de pluie et d'ennui, le jeune Paul, fils de paysans lozériens, trouve au grenier un petit tas de lettres adressées à une certaine Marie, prénom porté par sa mère. Mais qui est ce Marcel qui lui a écrit autrefois et dont Paul n'a jamais entendu parler ? Aidé de son frère Louis, il décide de retrouver la trace de ce mystérieux expéditeur. Les années passent et Paul s'éloigne vers la capitale où un travail l'attend tandis que Louis reprend l'exploitation familiale. Les moments partagés, désormais bien rares, les ramènent toujours vers leurs recherches. Leur persévérance finira-t-elle par porter ses fruits ? Quels secrets de famille les deux frères exhumeront-ils ? »
Lorsque j’ai ouvert ce livre, je m’attendais à un secret de famille, mystérieux, préoccupant… mais malheureusement, le roman manque de rythme et l’histoire s’allonge à n’en plus finir. Bien évidemment, j’ai terminé l’histoire, car riche de traditions lozériennes – qui en raviront plus d’un - d’explications sur le dur labeur au sein des fermes, l’émergence de la mécanisation, l’héritage du patrimoine - si cher au cœur des paysans – et cet orgueil paternel, si mal placé, qu’il en devient pathologique et destructeur.On ne va pas se mentir, ce roman du terroir se lit très bien ; l’auteure Marie de Palet a d’ailleurs été récompensée par la Ligue Auvergnate – en 2019 – pour l’ensemble de son œuvre.
Une lecture sympathique, mais pas transcendante....
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par FANNOU93 le 14 Juillet 2023 à 11:29
 Rouen, 1872, un fait authentique qui a mis en émoi, la Normandie, et même la France entière, à la fin du XIXe siècle.
Rouen, 1872, un fait authentique qui a mis en émoi, la Normandie, et même la France entière, à la fin du XIXe siècle.Le soir du 22 novembre 1872, un petit garçon de 10 ans Delphin Luce et une jeune fille de 20 ans Justine Boulard, sont agressés sur le chemin du retour de leur usine de tissage. L’enfant décède tandis que Justine tombe dans l’inconscience ; elle pourra toutefois affirmer reconnaître son agresseur ; mais ses incertitudes varient souvent, jusqu'au jour où elle accuse formellement Neveu, un contremaître qui rentrait, habituellement, avec eux.
Le juge d’instruction Julien Delavigne mène l’enquête : confrontations, arrestations, rumeurs, dénonciations, au cœur d’une société normande du XIXème siècle, encore meurtrie par la récente occupation prussienne, entre ville et campagne, bourgeoisie et monde ouvrier.
L’auteur Yves Jacob sera d’ailleurs récompensé par le prix Guillaume-le-Conquérant et le prix du Roman populaire.
Ce livre passionnant et vivant nous entraîne dans le déroulement de l’enquête puis du procès, tout en décrivant les conditions de vie normande et les relations entre les habitants.
Il va falloir attendre encore pas mal d’années avant que les investigations anthropologiques voient le jour !.... mais le meurtrier sera démasqué.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par FANNOU93 le 14 Juillet 2023 à 11:18
 Nous connaissons tous la tour Eiffel et nous sommes nombreux à l’avoir visitée. Mais qui connaît l’histoire de Gustave Eiffel ?
Nous connaissons tous la tour Eiffel et nous sommes nombreux à l’avoir visitée. Mais qui connaît l’histoire de Gustave Eiffel ? Ce livre est un roman biographique où les personnages, les dates, les lieux sont réels ; vous pensez bien que j’ai vérifié ! Et les dialogues sont construits à partir de correspondances ; un vrai travail de chercheur et de généalogiste.
Quatrième de couverture : « Ingénieur et inventeur de génie, Gustave Eiffel a bâti des édifices sur toute la planète, de la statue de la Liberté au viaduc de Garabit, de la gare de Budapest au pont de Porto. Il a connu la gloire et la descente aux enfers, les têtes couronnées et la prison. La construction de la Tour, clou de l'Exposition universelle de 1889, a constitué une incroyable aventure humaine et Gustave a dû se battre pendant vingt ans pour que son œuvre ne soit pas démolie. Patron social avant l'heure, capable de risquer sa vie pour sauver un ouvrier de la noyade, il est devenu à soixante-dix ans un pionnier de la météorologie et de l'aéronautique, au point que ses découvertes lui ont valu l'équivalent du prix Nobel. Veuf à quarante-cinq ans, il vouait un culte à sa fille Claire, mais n'a jamais oublié son amour de jeunesse, Adrienne Bourgès, retrouvée sur le tard.
Cette biographie romancée dévoile un personnage fascinant et pourtant méconnu, dont la créativité et les exploits industriels ont fait rayonner l'image de la France dans le monde entier. »
Si vous recherchez une lecture romanesque, passez votre chemin ; Eiffel était un travailleur et un inventeur acharnés, et ses obligations d'ingénieur et de chef d'entreprise ne laissaient aucune place au sentimentalisme. Pourtant, Eiffel était un homme brillant, entreprenant, où certaines femmes auront une place importance dans sa vie : sa mère tout d’abord, femme de tête et chef d'entreprise, puis sa sœur Marie, première confidente et alliée, viendra ensuite Marguerite, son épouse adorée et trop tôt disparue… et enfin sa fille aînée, Claire, sa complice la plus admirative ; et comment oublier le premier grand amour malheureux de sa vie : Adrienne, avec un grand A comme sa très célèbre tour…
Une lecture distrayante mais surtout instructive.
*
Alexandre Gustave Bonickhausen dit Eiffel est né le 15 décembre 1832 (AD21 n°713 page 249/497) à Dijon.
 Aux yeux de tous, Eiffel est le génie bâtisseur de l’Empire, un constructeur de l’extrême, un expert en ingénierie des structures en métal ; durant toute sa vie, il a contribué au développement de techniques de construction innovantes et s’est engagé dans les plus grandes avancées architecturales, technologies et industrielles de son temps : expositions universelles, grands magasins, usines, métro, grande hauteur, grande portée, nouveaux matériaux, préfabrication, ponts, charpentes métalliques...
Aux yeux de tous, Eiffel est le génie bâtisseur de l’Empire, un constructeur de l’extrême, un expert en ingénierie des structures en métal ; durant toute sa vie, il a contribué au développement de techniques de construction innovantes et s’est engagé dans les plus grandes avancées architecturales, technologies et industrielles de son temps : expositions universelles, grands magasins, usines, métro, grande hauteur, grande portée, nouveaux matériaux, préfabrication, ponts, charpentes métalliques...Chercheur inventif et toujours en mouvement, Eiffel nous est présenté comme un homme de conviction, un entrepreneur exceptionnel, qui sait s’entourer des meilleurs scientifiques et ingénieurs de son époque (Camille Flammarion, Thomas Edison….)
Sportif, trapu, un fort accent bourguignon, Eiffel était plus doué sur les chantiers auprès de ses ouvriers que pour la prise de parole en public ; doté d'une extraordinaire intelligence et d'une capacité de travail phénoménal, on pourrait peut-être aujourd’hui le qualifier d’HPI.
Même s’il était issu d’une famille de la haute bourgeoisie, Eiffel a toujours travailler pour gagner sa vie et devenir « le premier constructeur après Dieu »….. Il devra notamment se défaire de ce nom « Bonickhausen » patronyme de son père, Alexandre Bönickhausen dit Eiffel - originaire de la région de Rhénanie en Allemagne et ancien officier des armées napoléoniennes - et qui lui causera
 bien des tourments ; de même, la famille de sa mère, Catherine-Mélanie Moller, était d'origine alsacienne et l’on sait que l'Alsace a connu bien malgré elle plusieurs changements de souveraineté au fil de l'Histoire…. Eiffel se verra souvent qualifier de traître vendu à l'Allemagne et de juif par surcroît. Il lui faudra toutefois attendre 1880 pour être autoriser à ne s’appeler que « Eiffel » : certes Gustave Eiffel était né à Dijon, en Bourgogne, mais dans ces années qui suivent la guerre perdue contre la Prusse, la référence à un ancêtre venu plus d'un siècle auparavant s'installer en Bourgogne n'était pas bien acceptée.
bien des tourments ; de même, la famille de sa mère, Catherine-Mélanie Moller, était d'origine alsacienne et l’on sait que l'Alsace a connu bien malgré elle plusieurs changements de souveraineté au fil de l'Histoire…. Eiffel se verra souvent qualifier de traître vendu à l'Allemagne et de juif par surcroît. Il lui faudra toutefois attendre 1880 pour être autoriser à ne s’appeler que « Eiffel » : certes Gustave Eiffel était né à Dijon, en Bourgogne, mais dans ces années qui suivent la guerre perdue contre la Prusse, la référence à un ancêtre venu plus d'un siècle auparavant s'installer en Bourgogne n'était pas bien acceptée.Il faut croire que la force du vent n’était pas son seul ennemi….
Quoiqu’il en soit, après une vie bien remplie, Gustave Eiffel est décédé le 27 décembre 1923 à Paris (AD 75 n°2581 page 31/31) ; il a laissé un héritage important dans le domaine de l'ingénierie et reste une figure emblématique de l'histoire de la construction, dans le monde entier.
Pourtant, Gustave Eiffel était un personnage pas très sympathique à cotoyer....
*
 L’auteure Christine KERDELLAN est journaliste. Directrice de la rédaction de L’Usine Nouvelle après avoir été directrice adjointe de l’Express et directrice de la rédaction du Figaro Magazine, elle participe régulièrement à des débats télévisés et notamment à C dans l’air. Elle a écrit une quinzaine d’essais et de romans, dont « Alexis », biographie romancée d’Alexis de Tocqueville, ou « Dans la google du loup », un essai d’anticipation qui dénonce les agissements des grands du numérique.
L’auteure Christine KERDELLAN est journaliste. Directrice de la rédaction de L’Usine Nouvelle après avoir été directrice adjointe de l’Express et directrice de la rédaction du Figaro Magazine, elle participe régulièrement à des débats télévisés et notamment à C dans l’air. Elle a écrit une quinzaine d’essais et de romans, dont « Alexis », biographie romancée d’Alexis de Tocqueville, ou « Dans la google du loup », un essai d’anticipation qui dénonce les agissements des grands du numérique.*
Pour en savoir plus :
Gustave Eiffel Geneastar (Geneastar)
Claire Françoise Alexandrine EIFFEL (Geneanet)
Qui était Gustave Eiffel (Le site de la Tour Eiffel)
130 ans de la Tour Eiffel : l'histoire de Gustave Eiffel avec Dijon
Gustave Eiffel - Visites privées
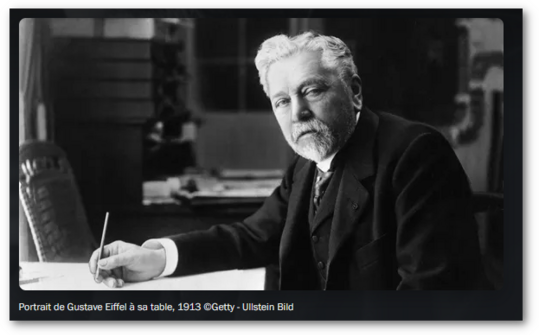
Histoire de la soufflerie rue Boileau
La construction de la tour Eiffel (YouTube)
Les Grandes constructions - La Tour Eiffel (YouTube)
Gustave Eiffel (1832-1923), l'homme du fer (Radio France)
Réalisations les plus notables de G. Eiffel (BTP Pro)
Gustave Eiffel (Gallica)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par FANNOU93 le 20 Mai 2023 à 10:32
 Voici un livre que je ne suis pas prête d'oublier....
Voici un livre que je ne suis pas prête d'oublier....Prénom : Marie Marguerite
Nom : MONVOISIN
Née en 1658
Fille d’Antoine Monvoisin et de Catherine Deshayes
Particularité : soupçonnée de complicité avec sa mère, brûlée vive en place de Grève en ce jour du 22 février 1680.
Nous sommes à Paris, en 1680, au cœur du plus grand scandale qui ébranla le règne de Louis XIV : l'Affaire des Poisons
442 accusés de commerce de sorcellerie
36 condamnés à mort pour acte de diablerie, dont sa mère La Voisin, comme on l’appelle
Et Marie Marguerite, sa fille ? Elle devra tout dire si elle veut sauver sa tête…..
Emprisonnée dans sa geôle à Vincennes, Marie-Marguerite devra en effet tout dire : livrer les secrets de sa mère, révéler ses formules et la liste de ses clients dans la haute noblesse courtisane.
« La vraie raison de son statut de recluse est le danger qu’elle fait courir aux geôliers. Si elle se retrouvait enceinte, la peine de mort serait immédiatement prononcée à l’encontre du responsable de sa garde.Mais qui se risquerait à fricoter avec cette jeune fille, que l’on dit née d’une orgie entre le diable et une sorcière ? On raconte qu’elle n’a pas de nombril, et qu’elle porte un troisième téton caché sous son corps. Preuve de son appartenance à la famille des démons. »
Ce livre est donc la confession de Marie Marguerite, expliquant comment sa mère l’a « préparée comme l’héritière de ses savoirs », comment « la boisson rendait sa mère maussade et bavarde » et surtout, comment du statut honorable de sage-femme, elle est devenue empoisonneuse, avorteuse, criminelle. Marie Marguerite est une enfant écartelée, mise à vif, souillée par les horreurs que sa mère a commises.

Au travers de ce récit, on découvre une Catherine Monvoisin, intelligente et réfléchie, mais surtout redoutable et insensible, libertine, terriblement infidèle et vulgaire. Mais une femme lucide : « chaque jour, je sonde la méchanceté et la fourberie des gens. »
Très tôt, la jeune Marie Marguerite a été initiée à la distillation des plantes et autres substances, à la fabrication de pommades, des onguents et bien sûr des poisons. Elle connaît tous les secrets de sa mère et a été le témoin des allers et venues de sa riche clientèle issue de la noblesse et de la Cour du Roi.
L’auteure ne nous épargne pas le langage cru, grossier, ordurier. D’ailleurs, dès les premières pages, elle souligne le travail délicat indispensable entre la rigueur historique qui s’impose, un français classique du XVIIème difficile à déchiffrer, et un vocabulaire abscons voire choquant : « dans cet exercice d’équilibre au service de la vraisemblance, mais aussi du pur bonheur d’écriture, il me fallait retrouver la veine qui a nourri mes précédents romans – récit historique, dialogues réalistes et insolents, dans l’esprit de l’humour grinçant que l’affectionne. »
Cette histoire nous plonge dans les bas-fonds de la sorcellerie, des rites occultes et des messes noires. Si nous entrons dans l'intimité de la plus célèbre des empoisonneuses, de son ascension à sa chute vertigineuse, nous parcourons aussi le quotidien des parisiens de cette époque où la place de la femme est sans cesse rappelée : « n’oublie jamais ça : je vends des remèdes à des femmes
 désespérées qui n’ont aucun droit ni aucun moyen honorable de gagner leur propre argent. Telle est la misère des nobles clientes qui fréquentent ma maison. De quoi nous les faire prendre en pitié quelquefois. » Parce que « naître fille est une malchance, mais chez les gueux, c’est une malédiction. » Ce qui résume – assez bien, à mon sens – la place des femmes dans ce siècle, et oserai-je ajouter pour quelques siècles encore…..
désespérées qui n’ont aucun droit ni aucun moyen honorable de gagner leur propre argent. Telle est la misère des nobles clientes qui fréquentent ma maison. De quoi nous les faire prendre en pitié quelquefois. » Parce que « naître fille est une malchance, mais chez les gueux, c’est une malédiction. » Ce qui résume – assez bien, à mon sens – la place des femmes dans ce siècle, et oserai-je ajouter pour quelques siècles encore…..Si au début du récit j’avais quelques considérations pour cette « Monvoisin » au vue d’une vie de labeur, mariée trop jeune à un « bras cassé trempé dans la vinasse »,et soucieuse semble t-il de gérer le sort peu enviable des femmes, très vite, j’ai rectifié mon jugement : Catherine a rapidement bercé dans un univers de débauche, sans aucune morale, comme atteinte d’une folie meurtrière.
« L'ambition de ces couillons est le lit de ma richesse. »
Isabelle DUQUESNOY dépeint avec réalisme le Paris du XVIIème, la Cour du Roi Soleil, s’appuyant sur des documents d’archives qu’elle a studieusement épluchés ; ce livre est nourri de récits historiques et des dialogues authentiques relatant les moeurs, les croyances, la vie quotidienne et le statut des femmes de l'époque, et que dire de la place des enfants…..
On y rencontre des personnages haut en couleurs : Monsieur de la Reynie, premier lieutenant de police sous Louis XIV, Adam Lesage (Coeuret), l’abbé Guibourg, les empoisonneuses Marie Bosse ou encore Françoise La Filastre, Mademoiselle Des Oeillets, la marquise Brinvilliers, et bien évidemment madame De Montespan.
Née à Paris en 1960, Isabelle DUQUESNOY est diplômée d'histoire et de restauration du patrimoine ; je ne vous cache pas que j’ai a-do-ré son livre, son style original, passant de l’humour à l’horreur, mais peut-être était-ce pour mieux nous présenter « l’inacceptable » et le « dérangeant ». Quoiqu’il en soit, il sera le premier d’une longue série….
*
Les ponts habités (Gallica)
La rue Beaureagard (Wikipedia)
Catherine DESHAYES (fiche Geneanet)
22 février 1680 : l’empoisonneuse Catherine Deshayes dite la Voisinest brûlée en place de Grève (La France Pittoresque)
Affaire des poisons. Année 1680, août-décembre (BnF)
L’affaire des poisons (Tombes et Sépultures)
Histoire de l’enfermement (Ministère de la Justice)
Archives de la Bastille – documents inédits (Gallica)
L'affaire des poisons : psychose à la cour de Louis XIV ( National Geographic)
L'Affaire des Poisons se déjoue à la Citadelle de Besançon (France Bleu)
L'Affaire des Poisons, une affaire d'Etat sous Louis XIV (France Inter)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par FANNOU93 le 25 Avril 2023 à 16:26
 L'histoire des sensibilités est une approche historique qui s'intéresse à l'étude des émotions et des sentiments dans le temps. Cette approche considère que les émotions sont des constructions sociales et culturelles qui évoluent au fil des siècles et des contextes.
L'histoire des sensibilités est une approche historique qui s'intéresse à l'étude des émotions et des sentiments dans le temps. Cette approche considère que les émotions sont des constructions sociales et culturelles qui évoluent au fil des siècles et des contextes.Vous allez me dire : « quel rapport avec la généalogie ? ». En matière de généalogie, on ne peut faire l’impasse sur « les sensibilités » de nos aïeux. Nous sommes nombreux à « essayer » d’écrire sur ce que nos ancêtres ont ressenti, exprimé voire refoulé…. Bien sûr ils ne sont plus là pour le dire, mais on peut essayer de savoir, de lire, d’écouter pour mieux comprendre…..
L'histoire des sensibilités explore les représentations culturelles des émotions, les normes sociales qui les régissent et les pratiques rituelles ou artistiques qui les mettent en scène. Nous voyons bien que nos aïeux étaient différents selon la région qu'ils habitaient - et les coutumes qui s'y rattachent - selon leur milieu social et professionnel.
L'histoire des sensibilités a connu un fort développement depuis les années 1990, notamment en France, avec des historiens comme Alain Corbin (Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot), Jean-Jacques Courtine ou bien encore Georges Vigarello. Elle s'est ensuite étendue à d'autres domaines de recherche, comme la littérature, l'histoire de l'art, la philosophie, la psychologie ou la sociologie.
Voici donc 5 podcasts de très grande qualité. Peut-être ne trouverez-vous pas la réponse à toutes les questions que vous vous posez, mais vous aurez quelques explications savamment développées....
*
Épisode 1/5 : Comment écrire l'histoire des émotions ?
Nos sens, nos passions et nos émotions ont une histoire. Comment retrouver la trace des sensations du passé au travers des archives et par le regard des historiennes et historiens ?
Épisode 2/5 : Je sens que je vais conclure… la séduction d'hier à aujourd'hui
Montrer ou dissimuler ses charmes fait le jeu de la séduction dans la société d'Ancien Régime, fondée sur la hiérarchie du sang et des sexes. Comment l'image d'un homme, séducteur, viril et conquérant, et celle d’une femme, chaste, pudique et passive, ont-elles imprégné les codes de l'amour ?
Épisode 3/5 : De colère, de tristesse, de joie… l'histoire, la larme à l'œil
Pleurer comme une madeleine, comme un crocodile, comme une fontaine ou comme un veau : comment écrire l'histoire des larmes ? Comment les manières de pleurer ont-elles évolué au cours du temps ? Les effusions et les larmes ont-elles connu des significations différentes selon les siècles ?
Épisode 4/5 : Ne rien laisser paraître, une histoire de l'insensibilité
Synonyme à la fois d’indifférence, d’absence de sens, de manque d’empathie, l’insensibilité est difficile à définir. Derrière celle-ci se cachent bien souvent des émotions tues ou enfouies. Comment l'histoire de l’insensibilité s'écrit-elle ?
Épisode 5/5 : L'impossible retour, la nostalgie à l'épreuve du temps
Si aujourd’hui le doux nom de nostalgie évoque en chacun de nous un sentiment de rêverie et nous transporte au temps de l’enfance, il n’en fut pas toujours ainsi. La nostalgie a d’abord été une maladie, dangereuse, redoutée, dont on pouvait même mourir…
Pour en savoir plus :
Les livres de Sylvie Steinberg
Les livres de Robert Muchembled
Anne Vincent-Buffault, Histoire des larmes XVIIIe-XIXe siècles)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par FANNOU93 le 22 Avril 2023 à 18:01
« Nombreux sont les généalogistes qui souhaitent retrouver l’histoire de leur commune où ont vécu leurs ancêtres. Les érudits ou les responsable de bulletin municipaux veulent également en savoir plus. Or, il n’est pas si facile de savoir où chercher et comment le faire, tant les piste que la curiosité peut suivre sont nombreuses : la cartographie, l’étude de l’école, de la mairie, de l’église, des bâtiments publics ou privés, des rues, l’histoire de la population à travers les communautés religieuses, les associations, les corporations, la conscription ou les évolutions administratives au cours des siècles sont autant de sujets de recherche, qu’il est possible d’étudier aussi bien sur un seul que sur plusieurs siècles.
Les archives communales sont riches de détails, mais elles ne sont pas les seules à pouvoir vous aider. Comme les arcanes des cadres de classement des documents anciens sont complexes, ce guide pratique vous fait découvrir les richesses des autres sites d’archives (départementales, nationales), celles des bases de données (en ligne ou non) ainsi que la possibilité de recherches dans les fonds privés, pas forcément accessibles au grand public. »
A la demande d’Archives et Culture, cet ouvrage a été rédigé, en 2011, par deux spécialistes des recherches sur l’histoire communale :
- Nicole ROUX, titulaire d’un DEA d’histoire moderne sur « la bourgeoisie Strasbourgeoise à la fin de l’Ancien Régime » est responsable de l’Action Culturelle et de la salle de lecture, chargée de la coordination du service éducatif aux Archives Départementales des Vosges depuis 2002 ; elle est chargée de visites guidées du service des archives comme des expositions qu’elle prépare et coordonne,
- Delphine SOUVAY, titulaire d’une maîtrise d’histoire moderne sur « la mort à Epînal aux XVIIème et XVIIIème siècle », est chargée des archives communales et des archives modernes(1800-1940) aux archives départementales des Vosges depuis 2002 ; elle est également chargée de recherches historiques ; elle est l’auteur de l’article paru dans les Annales de la Société d’émulation des Vosges, « Victor Demange (1870-1940), un spinalien citoyen du monde».
Voici très succinctement, les éléments que j’ai pu en tirer ; si vous voulez en savoir plus, bien évidemment, il vous faudra vous procurer ce livre très intéressant.
*
Avant de vous plonger dans les archives communales (ou municipales) consultez par exemple les sites d’histoires locales et/ou les clubs généalogiques du département concerné. Ils regorgent de « passionnés » qui se feront une joie de vous aider…..
Pour cet article et mes recherches futures, j’ai réalisé
- Le plan du classement des archives communales (AC)
- Le plan du classement des archives départementales (AD)
C’est cadeau, et indispensable pour la suite !
Les AD sont propres à chaque territoire ou régions tandis que les AC sont le reflet et l’histoire d’une même ville. AD ou AC, ce fut un réel plaisir de les « éplucher ».
Le classement des AN est plus complexe et se trouve en ligne (ici)
*
A. LES SOURCES
Les monographies communales : fruits d’une commande du Ministère de l’Instruction Publique qui souhaitait célébrer le centenaire de la Révolution Française ; vers 1888 (AD 71), le Ministère demande donc aux instituteurs de la République de décrire leur commune ; certains férus d’histoire dresseront un fidèle portrait, tandis que d’autres se contenteront d’un simple état des lieux, voire rien !

Dans chaque département, des annuaires font état de la structure administrative voire industrielle et/ou commerciale des communes ; on peut depuis peu les retrouver dans les ressources en ligne de Gallica (BnF numérisée)
- Série O des AD : administration et comptabilité communale / extraits de délibérations, des devis, des plans de budget
- Série L des AD : administrations et tribunaux de la période révolutionnaire / mise en place de nombreux chantiers durant cette période
Cas particulier d’une ville portuaire
Pour écrire l’histoire d’une commune, il est bon de se poser des questions pertinentes :
- cette ville a t-elle une histoire administrative mouvementée
- a t-elle été intégrée rapidement à la France
- a t-elle un passé militaire ou commercial : traite négrière, pêche à la morue, commerce des épices, chantiers navals, bagne….
Attention ! Les archives des bagnes de Toulon, Brest, Rochefort, Le Havre, Cherbourt, Lorient ou Nice se trouvent au Service Historique de la Défense (SHD)
- Pensez aux registres de l’inscription maritime qui recensent tous les professionnels du monde maritime
- Intéressez-vous aux activités de commerce en analysant les registres de chargement des bateaux….
Cas particulier d’une ville frontière
Le territoire de la France a souvent changé au fil des conquètes ou des régimes politiques. Les territoires ayant une histoire mouvementée ont des particularismes que l’on trouve dans des sources spécifiques ; il est donc indispensable de s’intéresser au contexte politico-administratif d’une région.
Par exemple, la commune de Schirmeck, actuellement dans le Bas-Rhin, appartenait au département des Vosges de 1795 à 1870.
Il faudra également prendre en compte la langue.
*
B. CARTOGRAPHIE ET TERRITOIRE
L’évolution de la cartographie
Lorsque l’on pense aux cartes anciennes, on pense immanquablement aux cartes de Cassini ; mais on peut aussi compléter ses recherches avec
-
les séries DD des AC : biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voiries
-
les séries G et H des AD concernant les archives cléricales anciennes : plans d’abbaye et/ou dépendances territoriales
-
la série B des AD qui propose les archives seigneuriales avant la Révolution : plan d’actes de propriété, litiges entre propriétaires
-
la série Q des AD où sont consigné les domaines, les enregistrements et les hypothèques
-
les archives notariales et la série P des AD qui recensent le cadastre et les contributions.
Le cadastre
Le cadastre napoléonien date de 1807 ; c’est un document composé d’un plan parcellaire, d’un tableau d’assemblage, d’un état de section et de matrices cadastrales.
Les rues et les quartiers
Outre les plans incontournables, il faudra s’intéresser à l’histoire de la ville pour mieux en comprendre l’évolution : constructions, guerres, démolitions, aménagements
-
Les recensements (tous les 5 ans à dater de 1836) donnent la profession des habitants, la configuration des quartiers, nomment les rues et les bourgs
-
La presse locale peut apporter des informations complémentaires sur les grands travaux
-
Un nom de rue est un « odonyme » ; pour trouver une maison, il fallait donner son numéro, mais aussi le côté de la rue ; ce n’est qu’avec le décret du 04/02/1805 que la numérotation est obligatoire, et encore, pas dans dans toutes les communes….
Attention !
Avoir une rue à son nom, ne prouve pas la célébrité. Par exemple, à Epinal, se trouve la place Edmond-Henry ; il s’agit d’un citoyen « lambda » mort à 30 ans : sa mère éplorée fit un leg important à la commune à la condition que le nom de son fils soit donné à une place de la ville.
La toponymie
C’est la science des noms de lieux ; elle s’intéresse à son étymologie ainsi qu’à ses transformations au cours de l’Histoire.
Elle classe les noms de deux manières :
L’école et la mairie ont souvent partagé les mêmes locaux
-
Série R des AC ou série T des AD
L’eau dans la ville
Fontaines, puits, lavoirs ont joué un rôle social très important.
-
Série M des AC
-
Sous-série F19, F13 et F21 pour le site de Paris et archives d’architectes au Centre des Archives du Monde du Travail à Roubaix
L’église et ses bâtiments sont des lieux où se retrouvent les habitants de la paroisse. Ils nécessitent beaucoup d’entretien et de travaux ; ils génèrent donc de nombreux documents pour payer le matériel et les artisans.
Bâtiments publics – Bâtiments privés
Si les régimes politiques se sont succédés, les bâtiments eux ont perduré.
-
Série B des AD
-
Série L (plan des monastères)
-
dans les Archives nationales
-
Base BORA (Base d'orientation et de recherche archivistique)
Les voies de communication
-
Le réseau routier : les travaux sur les routes sont d’abord liés à une corvée obligatoire pour les hommes qui devaient venir avec les animaux, outils et voitures / liste des corvéables CC ou DD des AC
-
Lex réseaux ferroviaire et fluvial se sont beaucoup développés au 19ème siècle : série S des AD
-
L'Atlas de Trudaine ou l’atlas des routes de France est un atlas géographique de France, recensant routes, chemins et abords ; il a été réalisé entre 1745 et 1780 sur ordre de Daniel-Charles Trudaine, administrateur des Ponts et Chaussées.
-
L’Atlas de Trudaine (AN)
*
C. LA VIE ADMINISTRATIVE ET LA POPULATION
Telles que nous les connaissons, les villes n’apparaissent qu’à partir de 1792. Elles sont mieux structurées avec
-
des élections communales : Série D des AC
-
des délibérations : Série M des AD ou CC des AC
-
un personnel communal : Série K des AC ou O des AD
 Les armoiries communales, très marginales avant la Révolution, sont intéressantes, car elles peuvent avoir évoluées en fonction de l’histoire de la commune.
Les armoiries communales, très marginales avant la Révolution, sont intéressantes, car elles peuvent avoir évoluées en fonction de l’histoire de la commune.Les cahiers de doléances sont souvent une source riche en matière de coutumes et d’habitudes.
Les terrains communaux : sous l’Ancien Régime, ce sont les chartes de franchise ou les droits d’usage qui en déterminent l’utilisation. Vous les trouverez aux AC, AD voire au service des Impôts.
Les prêtres des paroisses utilisent les registres paroissiaux pour raconter des évènements : Série F des AC et Série M des AD
S’intéresser à l’histoire d’une commune, c’est également traiter la démographie : natalité, mortalité, émigration, patronyme et questions sociales /
-
Avant la Révolution : Série C des AD et CC des AC
-
Après la Révolution :
-
Série 6M des AD (recensements)
-
Série F des AC
-
Série M des AD (listes électorales)
-
Série K des AC
-
*
D. LA VIE QUOTIDIENNE
La vie quotidienne était étroitement liée à la vie religieuse qu’elle soit catholique, juive, musulmane, protestante ou anglicane :
-
Les communautés religieuses : Séries G et H,des AD
-
Le curé et la vie paroissiale
Les communautés villageoises ont un rôle social primordial tant par l’aide aux plus démunis que par l’établissement d’organismes de charité :
-
Les sages femmes et les médecins : recensements des AD
-
les établissements de santé ( hôpitaux, sanatorium, hospices) : Série H, Série X des AD
-
Les bureaux de bienfaisance : Série X des AD et Q des AC
-
Les associations (descendantes des patronages) :
-
Série M des AD
-
Journal Officiel des Lois et Décrets
-
Série J des AD
-
Série G et H des AD (confréries)
-
Les corporations et les industries
Si l’industrie est au cœur de l’activité économique d’une ville, l’artisanat – qui en est à l’origine – règne alors en maîtres dans les cités :
-
Les corporations
-
Série E des AD
-
Série HH des AC
-
Série B des AD (fonds de baillage)
-
Série C des AD (intendance)
-
-
Les industries
-
Série M des AC
-
Série F 19 des AN
-
Série O et 5M des AD
-
Série P (activité d’un commerce)
-
Série R (dommages de guerre)
-
Série S (transport des marchandises
-
La vie à la campagne est souvent identique d’une région à l’autre ; c’est une vie de culture, soumise aux aléas climatiques, avec des changements d’activité entre l’hiver et l’été :
-
les monographies communales
-
Série M des AD
-
Les fonds privés
-
les archives d’associations
-
les syndicats agricoles locaux
-
L’industrialisation
-
La modification du paysage rural : Série M des AD
-
Les fonds privés
-
les ANMT (Archives Nationales du Monde du Travail)
-
La vie quotidienne à la ville est fonction de la physionomie de la ville.
Pour rappel, le tout-à-l’égout ne date que du milieu du 19ème siècle – et seulement pour Paris !
 De même, les premières poubelles datent de 1884 et ce n’est qu’après la révolution hygiéniste que naît la cité plus propre.
De même, les premières poubelles datent de 1884 et ce n’est qu’après la révolution hygiéniste que naît la cité plus propre.La ville fourmille de petits métiers (voir boite à outils sur mon site) ; pensez
-
aux commerces
-
aux papiers de famille : journaux, témoignages, photos…
-
à la vie culturelle et ses sources : représentations théâtrales, costumes, cinéma, casino, marchés (tissu, bétail, denrées alimentaires)….
La conscription
Villes et villages sont les premiers témoins de l’engagement de nos aïeux dans la vie militaire :
-
La circonscription militaire: SDH de Vincennes
-
La garde nationale, démantelée à la suite de la guerre 1870-1871 : AC
-
Les sapeurs pompiers : Série O et Série R des AD
-
Les douaniers et la gendarmerie : Série N des AD et Service Historique de la Gendarmerie.
Voici donc un tour d’horizon très vaste qui vous donne un certain nombre de piste à explorer.
Pour le reste, soyez créatif et partagez vos expériences ! On apprend toujours des autres...
Pour en savoir plus :
Portail de la cartographie (Wikipedia)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par FANNOU93 le 11 Avril 2023 à 21:45
 "Du moment que vous les défendez, vous partagerez leur sort ! " Et pour n'avoir jamais transigé avec qu'elle appelait les "valeurs premières", Adélaïde Hautval, dite Haïdi, va devoir traverser l'enfer et survivre à 37 mois d'emprisonnement et de déportation. En sa qualité de médecin, à Auschwitz, elle est affectée au Revier (l'infirmerie) où elle soulage et soigne avec ses maigres moyens. Dans les cas les plus graves, elle s'arrange pour maquiller le diagnostic et permet ainsi à nombre de ses patientes d'éviter la chambre à gaz. Elle doit aussi travailler au sinistre Block des expériences médicales sur la stérilisation. Elle réussit d'abord à ne faire que soulager les jeunes martyrisées, témoin des horreurs perpétrées par les médecins SS. Mais quand elle reçoit l'ordre de prêter la main aux actes criminels, elle refuse, s'opposant frontalement aux nazis.
"Du moment que vous les défendez, vous partagerez leur sort ! " Et pour n'avoir jamais transigé avec qu'elle appelait les "valeurs premières", Adélaïde Hautval, dite Haïdi, va devoir traverser l'enfer et survivre à 37 mois d'emprisonnement et de déportation. En sa qualité de médecin, à Auschwitz, elle est affectée au Revier (l'infirmerie) où elle soulage et soigne avec ses maigres moyens. Dans les cas les plus graves, elle s'arrange pour maquiller le diagnostic et permet ainsi à nombre de ses patientes d'éviter la chambre à gaz. Elle doit aussi travailler au sinistre Block des expériences médicales sur la stérilisation. Elle réussit d'abord à ne faire que soulager les jeunes martyrisées, témoin des horreurs perpétrées par les médecins SS. Mais quand elle reçoit l'ordre de prêter la main aux actes criminels, elle refuse, s'opposant frontalement aux nazis. *
Médecin et résistante française, Adélaide Hautval est née en 1906. Fin septembre 1939, elle quitte l’Alsace où elle a étudié la médecine puis la psychiatrie, pour s’occuper des patients de l’hôpital psychiatrique de Vauclaire dans les Hautes Pyrénées. Mais son destin bascule fin mai 1942, arrêtée par la « Feldgendarmerie » en gare de Vierzon, sur la ligne de démarcation. Indignée par les rafles des irsraélites, elle ose s’interposer et prendre la défense d’une jeune juive : « du moment que vous les défendez, vous partagerez leur sort ! » Son sort était scellé en effet, la voici embarquée à la prison de Bourges.
Mais avant d’arriver à Auschwitz-Birkenau, elle partage le long périple des femmes déportées d’un camp de transit à un autre.
Juin 1942 : 1er camp à Pithiviers, sous la surveillance des gendarmes et des douaniers français.
« Toutes ont été arrachées de chez elles sans qu’il leur ait été possible de prendre certaines dispositions nécessaires. »

Elle y retrouvera No Rabinovitch (voir La Carte Postale). Très vite, elle est confrontée aux femmes atteintes de dysenteries graves, coqueluches, scarlatines, diphtéries, rougeoles, et puis celles qui sont devenues folles….. Arrive alors ce terrible moment où mères et enfants sont séparés : « ce qui paraît impossible arrive quand même. »
Fin septembre 1942 : le camp est évacué pour Beaune La Rolande, puis le Fort de Romainville. A côté des « criminelles » sont rassemblés tous les prisonniers communistes.
5 novembre 1942 : transfert à la prison d’Orléans puis retour au fort de Romainville.
21 janvier 1943 : c’est Compiègne puis départ pour Auschwitz dans « les wagons à bestiaux ».
 Comme ses co-détenues, elle s’imaginait les casernes, le travail en usine, mais certainement pas ça : « nous croisons des files d’hommes, aux costumes rayés. Puis des femmes. Têtes rasées. Des faces hébétées. L’une d’elles, qui à l’air de commander, tape dessus. (…) Premier contact avec un monde inconnu où le renversement des valeurs fait loi.
Comme ses co-détenues, elle s’imaginait les casernes, le travail en usine, mais certainement pas ça : « nous croisons des files d’hommes, aux costumes rayés. Puis des femmes. Têtes rasées. Des faces hébétées. L’une d’elles, qui à l’air de commander, tape dessus. (…) Premier contact avec un monde inconnu où le renversement des valeurs fait loi.Fils de fer électrifiés qui se perdent à l’infini. La détresse menace de nous envahir et , comme défi, toutes nous chantons La Marseillaise avant d’entrer. » Elles sont des « verkommenes volk », un peuple dégénéré comme ils disent les « kapos » et les SS.
Adélaide Hautval est rapidement affecté comme médecin au bloc des Allemandes. La « Blockälteste » (chef de bloc détenue) est une « triangle noir » mais elle a le sens de la justice et une véritable estime s’installe entre les deux femmes.
Pour son plus plaisir, les SS ont peur de la contagion et n’entrent pas au Revier (infirmerie) où elle essaie de soulager au mieux. Si les médecins Wirths, Rhode, König sont des « exécuteurs dociles des ordres donnés » , le Dr Mengele, quant à lui, est « un détraqué, un dangereux ». Elle va être sollicitée pour seconder ces médecins criminels pour mener à bien des expériences sur les déportées ; mais au péril de sa vie, elle leur opposera des refus sans appel.

Adélaide Hautval se bat pour sauver les femmes ; elle ruse pour les préserver de la solution finale et refuse de participer à la « sélection »….. Elle s’interroge continuellement : « si nous avions plus de courage, nous protesterions au lieu de laisser faire. Je me suis souvent demandée ce qui se passerait si à ces moments-là on essayait d’intervenir. Geste inutile ? Peut-être, mais ce n’est pas sûr. Il faut souvent si peu pour changer le cours des évènements, et un simple geste peut en susciter d’autres. » La peur est une arme puissante.
Janvier 1944 : le groupe des Françaises est transféré à Ravensbrûck.
Janvier 1945 : les convois arrivent toujours plus nombreux ; les sélections se poursuivent à un rythme de plus en plus effréné ; les Allemands ne peuvent plus cacher l’avance inexorable des Russes. Il faudra avancer coûte que coûte et les malades devront être tous exécutés. Eux qui
 portent inscrit sur leur ceinturon « Gott mit us » (Dieu avec nous)
portent inscrit sur leur ceinturon « Gott mit us » (Dieu avec nous)La Libération arrive, mais elle ne fuit pas, comme beaucoup, légitimement ; elle, elle choisira de prolonger son séjour pour tenter de sauver ceux et celles qui n’ont plus la force de partir…..
Ce récit est un document bouleversant ; victime de la barbarie nazie, le Dr Adélaïde Hautval a fait preuve d’un dévouement admirable et d’une très grande force de caractère. Comme de nombreux témoignages, elle parle bien évidemment du froid, de la faim, de la fatigue, du manque d'hygiène, des sévices et des humiliations, de l'absence de médicaments, mais aussi de ses « ruses » pour éviter que des femmes soient envoyées à la mort ; elle évoque également son refus de participer aux expériences médicales sans aucun but scientifique.
Un livre difficile à lire, tant il est cruel, à vif et …. révoltant. Mais un livre qu’il me fallait absolument terminer.
« Notre rôle n’est pas de juger. Mais à nous qui ne savons que trop jusqu’où peuvent mener la volonté de puissance et le mythe de la race supérieure, il appartient de lutter de toutes nos forces contre le danger toujours renaissant. »
Une belle leçon de vie qui me confirme bien que le combat n'est jamais fini.....
*
Pour en savoir plus :
Les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande (le CERCIL)
Camp de Beaune-la-Rolande (AJPN)
Le fort de Romainville ou la mémoire des murs
Le camp de Royallieu à Compiègne (1941-1944)
Les expérimentations médicales à Auschwitz
Commando de la mort. Camps de concentration de Auschwitz
« Criminels de guerre » : nouvelle collection exceptionnelle pour Une histoire particulière (France Culture)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par FANNOU93 le 9 Avril 2023 à 13:59
Le Service Historique de la Défense (SHD) de Caen est un centre d'archives militaires situé à Caen en Normandie, France. Il conserve les archives du ministère de la Défense relatives à l'histoire militaire française depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours.
Le SHD de Caen est divisé en plusieurs départements qui couvrent différentes périodes de l'histoire militaire française, tels que le département de l'époque moderne, le département de la Première Guerre mondiale, le département de la Seconde Guerre mondiale, etc. Les archives conservées comprennent des documents officiels, des correspondances, des plans, des photographies, des cartes, des journaux de guerre et bien d'autres types de documents.
*
Une équipe de France 3 Caen s'est immergée au sein du Service Historique de la Défense de Caen Dans cet épisode, visite guidée de ce précieux lieu de mémoire par son responsable, Alain Alexandra, chef de la division des archives des victimes des conflits contemporains.
Episode 1/4. Un reportage de Pierre-Marie Puaud, Jean-Michel Guillaud, Cyril Duponchel, Bastien Odolant, Clothilde Moschetti, Amandine Myhié et Marc Michel (cliquez sur l'image ci-dessous)
Episode 2/4. Une équipe de France 3 Caen s'est immergée au sein du Service Historique de la Défense de Caen Dans cet épisode, Mireille Riffaud part à la recherche d'informations sur ses deux oncles, prisonniers en Allemagne pendant la seconde guerre mondiale. Elle est accompagnée dans ses recherches par le responsable du centre d'archives, le chef de division Alain Alexandra
Un reportage de Pierre-Marie Puaud, Jean-Michel Guillaud, Bastien Odolant, Choltide Moschetti, Amandine Myhié, Marc Michel (cliquez sur l'image ci-dessous)
Episode 3/4. Une équipe de France 3 Caen s'est immergée au sein du Service historique de la Défense situé à Caen, dirigé par le chef de Division Alain Alexandra. Dans cet épisode, rencontre avec Arnaud Bouligny, chercheur à la Fondation pour la mémoire de la déportation, qui , depuis plus de vingt ans, a entrepris avec ses collègues chercheurs un minutieux recensement des victimes de la barbarie nazie.
Un reportage de Pierre-Marie Puaud, Jean-Michel Guillaud, Bastien Odolant, Clothilde Moschetti, Marc Michel (cliquez sur l'image ci-dessous)
Episode 4/4. Une équipe de France 3 Normandie s'est immergée au sein du Service historique de la Défense à Caen Dans cet épisode, rencontre avec un étudiant en histoire, Joseph Piccinato, qui est depuis de nombreux mois un habitué de la salle de lecture. Pour son mémoire de recherche consacré aux karkis pendant la guerre d'Algérie, cet étudiant de l'université de Caen consulte de nombreux dossiers d'archives, accompagné par le responsable du centre , le chef de division Alain Alexandra.
Un reportage de Pierre-Marie Puaud, Jean-Michel Guillaud, Clothilde Moschetti, Bastien Odolant, Marc Michel (cliquez sur l'image ci-dessous)
Pour en savoir plus :
Le Service Historique de la Défense (2019)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par FANNOU93 le 22 Mars 2023 à 18:20
 Voici un petit livre de 115 pages, petit, mais « un peu » compliqué à lire…. Mais totalement dans la continuité de mes recherches généalogiques.
Voici un petit livre de 115 pages, petit, mais « un peu » compliqué à lire…. Mais totalement dans la continuité de mes recherches généalogiques.« Cet ouvrage s'intéresse aux effets psycho-traumatiques vécus par les descendants de survivants déportés - et plus précisément, à la 3ème génération – ayant côtoyé la mort des mois ou des années durant. En croisant des travaux pluridisciplinaires de psychanalystes, de sociologues et de médecins, il investigue le vaste sujet du traumatisme, qui demeure en outre d’actualité.
Le psycho-traumatisme se transmet-il ? Quels en sont les effets sur l'ensemble de la lignée familiale d’un vaste massacre humain ? Quel rôle l’enfant parvient-il à se créer au sein de sa famille ; sera t-il en mesure de s’y situer ?
Autant de questions sur lesquelles Marie-Laure Balas-Aubignat s’est penchée, en interviewant une dizaine de petits-enfants de survivants. Un livre qui pourra intéresser toute personne qui a été confrontée, d’une façon ou d’une autre, à un traumatisme collectif, ainsi que tout étudiant ou professionnel en sciences humaines et sociales. »
*
L’auteure Marie-Laure Balas-Aubignat – psychanalyste psychologue clinicienne – explique qu’il existe deux types de traumatisme :
-
soit le fait d’être confronté à une situation dans laquelle les défenses disponibles ne sont pas suffisantes pour endiguer l’afflux pulsionnel (Freud 1920),
-
soit le fait d’être soumis à une entreprise délibérée de destruction de l’enveloppe ; Tobie Nathan en 1991 nomme ce dispositif « logique traumatique ».
Le livre de M-L Balas-Aubignat porte sur ce deuxième type de traumatisme, passant en revue les travaux de différents scientifiques sur le sujet.
F. Sironi (1989) a étudié le système « tortionnaire / torturé » afin d’en dégager les processus intervenant dans le traumatisme intentionnel, en décrivant les techniques utilisées :

-
mécanismes de douleurs,
-
privations, effroi,
-
transgression des tabous culturels et déshumanisation,
-
brouillage des repères sensoriels,
-
instauration d’un code obsessionnel,
-
situation de perversion logique.
Nathalie Zajde ( 1992) identifie les deux premières générations dans la population juive vivant en France :
-
les survivants qui ont connu le traumatisme de l’extermination,
-
les enfants de survivants,
et discerne leur « double nature » : celle du temps de l’extermination et celle du retour à la vie normale. Elle définit alors les mécanismes de transmission du traumatisme.
Tous les survivants expriment les mêmes temps fondamentaux de déconstruction de la personnalité :
-
dépersonnalisation (Cohen, 1953)
-
schizophrénie (Bethelheim, 1952)
-
anesthésie psychique et dédoublement de la personnalité (Lifton, 1967 et 1986)
Par mesure de protection, les survivants sont donc devenus « un autre », une altérité déstructurante. Après avoir intériorisés leurs cauchemars, ils doivent faire face à un second traumatisme : « celui de l’adaptation quasi immédiate au monde des vivants ».
 William G. Niederland en 1968 et Léo Eitinger en 1961 ont étudié les principaux signes psycho pathologiques et traits de personnalité (DSM III / Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux ) :
William G. Niederland en 1968 et Léo Eitinger en 1961 ont étudié les principaux signes psycho pathologiques et traits de personnalité (DSM III / Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux ) :-
sentiment de peur, de terreur et d’abandon,
-
reviviscence de l’évènement traumatique,
-
évitement de stimuli liés à l’évènement,
-
hyperactivité neurovégétative,
-
rêves traumatiques,
-
souvenirs récurrents,
-
périodes sensibles au moment des anniversaires,
-
états dissociatifs,
-
irritabilité particulière,
-
perte de la capacité de concentration,
-
labilité émotionnelle,
-
réduction de la capacité de modulation des affects,
-
peurs et soucis injustifiés et excessifs.
Aucune transition entre les deux mondes : avant et après. Les traumatismes ont donc induits chez les survivants ce que Sandor Ferenczi (1982) appelle « un clivage du moi ».
Toutes les douleurs ont été intériorisées : « la torture est utilisée pour faire parler, mais pour faire taire aussi » (F. Sironi 1997)

Les enfants des survivants sont devenus « la crypte » abritant d’indicibles secrets (F. Sironi 1991). Le traumatisme perdure de génération en génération : c’est l’identité négative du survivant qui se « duplique » chez son enfant (N. Zajde 1996) ; les enfants de survivants sont donc condamnés à devenir les garants de l’évènement traumatique (Abraham et Torok 1978) ; l’enfant est un réparateur, un support d’étayage ; il reste collé au traumatisme parental.
« L’enfant est soumis à une telle emprise qu’il se trouve comme confronté à un interdit de symbolisations dans la succession des générations » (J. Altounian, 2000).
Les enfants de survivants occupent une double fonction :
-
une fonction vitale : un enfant surinvesti, lorsque par exemple, il porte le même nom qu’un mort de la famille dans le camps,
-
une fonction d’oubli : rappeler l’origine, empêcher l’oubli, le déni, afin de ne pas sombrer et accentuer le vide provoqué par les SS.
Et l’auteure conclut : « comme si le petit enfant tentait de réinscrire sa mère (2ème génération) dans les traces de ses parents (1ère génération) pour rétablir un lien, une enveloppe maternante qui lui a fait défaut petite. »
*
Bourreaux et victimes de F. Sironi
Traces psychiques, mémoires cryptées et catastrophes historiques (Cairn)
Leo Eitinger, le psychiatre sorti d’Auschwitz
La découverte impardonnable de Ferenczi (Cairn)
Sándor Ferenczi (1873-1933) (France Culture)
Maria Torok, les fantômes de l'inconscient (Cairn)
L’Oeuvre de Nicolas Abraham et Maria Torok
La clinique psychanalytique à partir de l'œuvre de Nicolas Abraham et de Maria Torok (Cairn)
“ La survivance, traduire le trauma collectif ” de Janine Altounian (Cairn)
 votre commentaire
votre commentaire
-
-
Par FANNOU93 le 4 Mars 2023 à 21:46
 Quatrième de couverture : « Hantée par des rêves de chevaux fous aux prénoms familiers, poursuivie par la question que sa fille pose à tout propos - a Elle est où, la maman ? " -, Marie vit un étrange été, à la croisée des chemins. Quand, sur le socle d'une statue de la Vierge au milieu du causse, elle découvre l'inscription Et à l'heure de notre ultime naissance, elle décide d'en explorer la mystérieuse invitation. Dès lors, elle tente de démêler l'écheveau de son héritage. En savoir plus sur ses aïeules qui, depuis le mitan du XIXe siècle, ont donné naissance à des petites filles sans être mariées, et ont subsisté souvent grâce à des travaux d'aiguille, devient pour elle une impérieuse nécessité. Elle interroge ses tantes et sa mère, qui en disent peu ; elle fouille les archives, les tableaux, les textes religieux et adresse, au fil de son enquête, quantité de questions à un réseau de femmes, historiennes, juristes, artistes, que l'on voit se constituer sous nos yeux. Bien au-delà du cercle intime, sa recherche met à jour de puissantes destinées. A partir .des vies minuscules de ses ascendantes, et s'attachant aux plus émouvants des détails, Marie imagine et raconte ce qu'ont dû traverser ces "filles-mères ", ces "ventres maudits" que la société a malmenés, conspués et mis à l'écart. A fréquenter tisserandes et couturières, à admirer les trésors humbles de leurs productions, leur courage et leur volonté de vivre, la narratrice découvre qu'il lui suffit de croiser fil de trame et fil de chaîne pour rester ce cheval fou dont elle rêve et être mère à son tour. Car le motif têtu de ce troublant roman, écrit comme un pudique hommage à une longue et belle généalogie féminine, est bien celui de la liberté, conquise en héritage, de choisir comment tisser la toile de sa propre destinée. »
Quatrième de couverture : « Hantée par des rêves de chevaux fous aux prénoms familiers, poursuivie par la question que sa fille pose à tout propos - a Elle est où, la maman ? " -, Marie vit un étrange été, à la croisée des chemins. Quand, sur le socle d'une statue de la Vierge au milieu du causse, elle découvre l'inscription Et à l'heure de notre ultime naissance, elle décide d'en explorer la mystérieuse invitation. Dès lors, elle tente de démêler l'écheveau de son héritage. En savoir plus sur ses aïeules qui, depuis le mitan du XIXe siècle, ont donné naissance à des petites filles sans être mariées, et ont subsisté souvent grâce à des travaux d'aiguille, devient pour elle une impérieuse nécessité. Elle interroge ses tantes et sa mère, qui en disent peu ; elle fouille les archives, les tableaux, les textes religieux et adresse, au fil de son enquête, quantité de questions à un réseau de femmes, historiennes, juristes, artistes, que l'on voit se constituer sous nos yeux. Bien au-delà du cercle intime, sa recherche met à jour de puissantes destinées. A partir .des vies minuscules de ses ascendantes, et s'attachant aux plus émouvants des détails, Marie imagine et raconte ce qu'ont dû traverser ces "filles-mères ", ces "ventres maudits" que la société a malmenés, conspués et mis à l'écart. A fréquenter tisserandes et couturières, à admirer les trésors humbles de leurs productions, leur courage et leur volonté de vivre, la narratrice découvre qu'il lui suffit de croiser fil de trame et fil de chaîne pour rester ce cheval fou dont elle rêve et être mère à son tour. Car le motif têtu de ce troublant roman, écrit comme un pudique hommage à une longue et belle généalogie féminine, est bien celui de la liberté, conquise en héritage, de choisir comment tisser la toile de sa propre destinée. »*
Nous avons tous commencé notre arbre généalogique en questionnant notre famille ; certains ont pu avoir de rares informations, d’autres ont dû prendre leur bâton de pèlerin et parcourir les
 chemins de traverse pour avoir quelques brides de réponses.
chemins de traverse pour avoir quelques brides de réponses.L’auteur Marie Richeux s’est laissée prendre au piège dans les trames de son histoire tout en s’appliquant à démêler chaque fil de ses découvertes : l’hôtel-Dieu de Reims, hospices pour indigents et mères célibataires, des toiles, des broderies et des courtepointes.
J’ai bien failli manquer ce rendez-vous, puisqu’il m’a fallu arriver à la page 83 pour enfin me sentir embarquée dans l’aventure ! … et seulement lorsque l’auteure commence à fréquenter les archives pour retrouver des traces de sa filiation ; elle découvre alors sur plusieurs générations des « filles-mères » toutes liées entre elles par le même métier :
« Je visualisai les lettres fines et penchées de l’acte de naissance d’Ernestine, et mon sursaut du cœur, à la énième lecture de l’acte, devant le métier de sa mère Marie-Julie : tisseuse. Ernestine avait été couturière, l’état civil et les archives le confirmaient, mais il apparaissait que le travail du fil unissait toutes les générations : Marie-Julie tissait, sa mère Marie, tissait, son père Jean, tissait et des deux frères aussi. »
Marie est submergée par ses réflexions, tentant de trouver des réponses à ces transmissions, au regard de la société sur ces femmes :
« Qu’est ce qui avait motivé pendant des siècles la haine et le rejet dont les filles-mères étaient l’objet ? Le fait qu’elles ne soient pas mariées ? Ou le fait que l’absence de mariage rende leur sexualité crue, visible, réelle en somme, pas abritée, pas surveillée, pas régulée ? C’est cela qu’on avait voulu tuer et c’est peut-être cela que je traversais ma manière, bien des années plus tard et dans une toute autre condition. Me dire enceinte, c’était apparaître dans l’habit souillé de la sexualité des femmes. »
L’auteure se laisse embarquer par le plaisir de l’enquête généalogique ; elle nous entraîne avec elle au gré de ses découvertes – et de ses rêves ! « en suivant la piste des sœurs brodeuses » de l’Hôtel-Dieu de Reims ; même s’il subsiste des interrogations sur la peur de l’abandon, de la mort, bien sûr, les douleurs de l’enfantement, douleurs accentuées par l’absence d’un mari, elle pose ses questions sur
- les méthodes de l’abandon et son éventuelle reconnaissance,
- la pratique de la couture et les techniques de broderies « religieusement » conservées,
- les maisons d’internement des filles illégitimes.
Dans les archives municipales de Reims, la BNF ou Gallica, les Archives Hospitalières, elle
 recherche de possibles réponses au travers de l’« agitation sociale », de « la rudesse » du travail et du quotidien de ces « véritables misères de vie ».
recherche de possibles réponses au travers de l’« agitation sociale », de « la rudesse » du travail et du quotidien de ces « véritables misères de vie ».« Dans les archives de l’état civil, j’avais retrouvé, à la génération suivante, ce même délai entre la naissance de Madeleine en tant que fille naturelle par sa mère Ernestine. J’en avais fait l’occasion d’épaissir le mystère. Avaient-elles songé un instant à abandonner leur enfant ? Avaient-elles hésité à être mères ? (….) Je voulais et ne voulais pas savoir. »
Elle est émerveillée devant les broderies des femmes, les courtepointes rémoises, mais toujours avec tendresse, respect et poésie.
« Je savais cela et je venais de faire un grand détour par le XIXème siècle pour prendre ma place dans le peuple secret des tisserandes. » Alors elle coud et découd des histoires au gré des pages des registres d’archives : « il y avait là un vêtement qui me tombait parfaitement sur le corps. Tisser, penser, donner naissance. »
Marie prend alors conscience, trame après fils, que nous avons toutes, dans nos généalogies, « des femmes, qui, pour sortir de leur condition crasse, ont cousu, à la fois pour survivre et aussi pour créer du beau. »
Voilà un ouvrage bien difficile à résumer ; le style est élégant, empreint de délicatesse et de
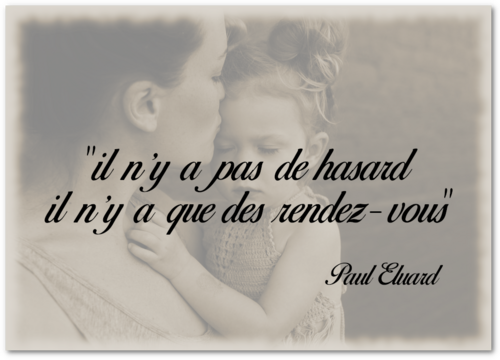 sensibilité. Il est une quête : Marie cherche sa place dans cet immense communauté de femmes brodeuses-tisseuses….
sensibilité. Il est une quête : Marie cherche sa place dans cet immense communauté de femmes brodeuses-tisseuses….« C’était donc ainsi que l’on grandissait, empruntant aux autres, rejouant leur scènes, décalant leurs gestes, leurs bonheurs et leurs chagrins. (…) Je repensai aux couturières, qui n’étaient pas putes. Je repensai à toutes ces femmes, mères d’enfants considérés comme illégitimes, qui, si elles n’étaient pas toujours traitées de putains, l’étaient aux yeux d’une grande part de la société. »
Ce livre m’a ému ; il m’a touchée car une branche de ma famille, après avoir quitté son Alsace natale en 1872, s’est réfugiée à Reims.
*
Pour en savoir plus :
Exposition Sheila Hicks à Pompidou
Métier à tisser : Sages femmes de Marie Richeux
Histoires de transmission avec Marie Richeux • Podcast Les Éclaireurs de Dialogues
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par FANNOU93 le 25 Février 2023 à 10:56
 Quatrième de couverture : « La carte postale est arrivée dans notre boîte aux lettres au milieu des traditionnelles cartes de voeux. Elle n’était pas signée, l’auteur avait voulu rester anonyme. Il y avait l’opéra Garnier d’un côté, et de l’autre, les prénoms des grands-parents de ma mère, de sa tante et son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Vingt ans plus tard, j’ai décidé de savoir qui nous avait envoyé cette carte postale, en explorant toutes les hypothèses qui s’ouvraient à moi.
Quatrième de couverture : « La carte postale est arrivée dans notre boîte aux lettres au milieu des traditionnelles cartes de voeux. Elle n’était pas signée, l’auteur avait voulu rester anonyme. Il y avait l’opéra Garnier d’un côté, et de l’autre, les prénoms des grands-parents de ma mère, de sa tante et son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Vingt ans plus tard, j’ai décidé de savoir qui nous avait envoyé cette carte postale, en explorant toutes les hypothèses qui s’ouvraient à moi. Ce livre m’a menée cent ans en arrière. J’ai retracé le destin romanesque des Rabinovitch, leur fuite de Russie, leur voyage en Lettonie puis en Palestine. Et enfin, leur arrivée à Paris, avec la guerre et son désastre.
J’ai essayé de comprendre pourquoi ma grand-mère Myriam fut la seule qui échappa à la déportation. Et d’éclaircir les mystères qui entouraient ses deux mariages.
Le roman de mes ancêtres est aussi une quête initiatique sur la signification du mot “Juif” dans une vie laïque. »*
Lélia Picabia, la mère de l’auteure, reçoit une carte postale, anonyme, représentant l'Opéra Garnier, mentionnant l'adresse de la destinataire, ainsi que quatre prénoms inscrits les uns en dessous des autres : Ephraïm, Emma, Noémie, Jacques. Ceux de ses grands-parents maternels, de sa tante et de son oncle, tous décédés en déportation durant la Seconde Guerre mondiale.
Myriam, la grand-mère est la seule à échapper au funeste destin de la famille entière. Elle a laissé à sa fille et à ses deux petites-filles le terrible poids d'un silence étourdissant…

À la fois récit des origines et enquête familiale, ce roman se dévore. IL était donc impensable pour moi de ne pas partager cet excellent récit familial, tant il est riche de réflexions et de repères historiques. Parce que - vous commencez à me connaître - j’ai vérifié chaque information, ayant le souhait de compléter mes quelques connaissances.
Loin de moi l’idée de juger nos aïeux – qui suis-je pour oser même y penser ! - je me suis toujours demandée pourquoi tous ces gens ne s’étaient jamais révoltés, d’autant plus qu’ils étaient en nombre plus importants que leurs tortionnaires.
Je cherche simplement à comprendre ; c’est d’ailleurs ce qu’Anne BEREST et sa mère ont fait : investiguer dans les boites d’archives pour rassembler, découper, reconstruire la mémoire de sa famille et restaurer avec intelligence l’histoire funeste des Rabinovitch.
« En Egypte, insistait Nachman, les Juifs étaient esclaves, c’est-à-dire : nourris et logés. Ils avaient un toit sur la tête et de la nourriture dans la main. Tu comprends ? La liberté, elle, est incertaine. Elle s’acquiert dans la douleur. L’eau salée que nous posons sur la table le soir de Pessab représente les larmes de ceux qui se défont de leurs chaînes. Et ces herbes amères nous rappellent que la condition de l’homme libre est par essence douloureuse. Mon fils, écoute-moi, dès que tu sentiras le miel se poser sur tes lèvres, demande-toi : de quoi, de qui, suis-je l’esclave ?
Ephraim sait que son âme révolutionnaire est née là, dans les récits de son père. »
Avec intelligence et respect, Anne Berest décortique le processus de recherche pour écrire son roman familial ; au fur et à mesure que l’on tourne les pages, que l’on avance dans l’investigation, je comprends mieux certaines répercussions sur le présent ; ce livre est toutefois très éprouvant, grave, sensible, et je dirai même pudique...
 J’ai enfin compris pourquoi toutes ces personnes ont gardé le silence….
J’ai enfin compris pourquoi toutes ces personnes ont gardé le silence….
« Les déportés s’allongent sur les tapis parce qu’ils ne réussissent plus à être dans un lit. Souvent ils sont à plusieurs les uns contre les autres, pour trouver le sommeil. Tous se sentent humiliés, avec leurs crânes rasés, les abcès et les phlegmons qui infectent leurs peaux. Ils savent qu’ils font peur. Ils savent que c’est une souffrance de les regarder. »Cette carte postale mériterait d'être lue par tous, et notamment expliquée aux lycéens qui, je n’en doute pas, ne seraient pas insensibles au destin de la famille Rabinovitch ; je n’avais que 14 ans lorsque mon collège a passé le terrible film « Nuit et Brouillard »….
Ce livre est un formidable support d’histoire et aborde :
-
les juifs discriminés en Russie
-
l’envahissement de la Pologne ; « les français et les anglais lancent de faibles offensives, ils semblent ne pas véritablement y croire. »
-
la guerre, avec son lot de morts, de déplacés, d’expulsés et de couvre-feux
-
les Allemands sur la capitale : Hitler visite Paris le 23 juin 1940 ; « son monument préféré l’opéra Garnier, avec son architecture néo-baroque. » (…) L’idée est de promouvoir la qualité de vie française. Une expression yiddish est cyniquement détournée pour devenir un slogan nazi, Glücklich wie Gott in Frankreich – Heureux comme Dieu en France ».
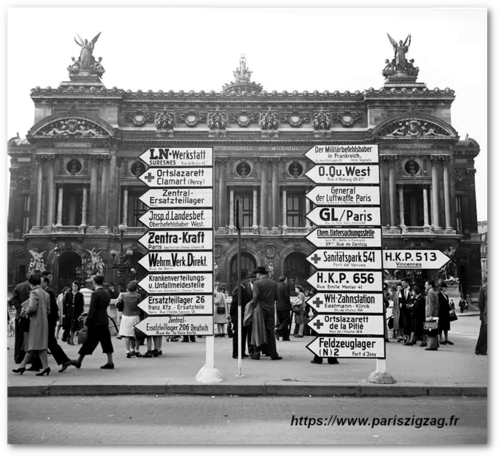
-
le quotidien des parisiens : les écoles réquisitionnées, la croix gammée flottant sur les bâtiments officiels, le nom des rue inscrit en allemand, les tickets de rationnement pour faire ses cours et « les civils doivent aveugler toutes leurs fenêtres en les recouvrant de satinette noire, ou d’un coup de peinture, afin d’éviter le signalement des villes aux avions alliés. »
- Pétain, chef d’état français, sa politique de rénovation nationale et le début de la répression contre les juifs : « Le propre de cette catastrophe réside dans le paradoxe de sa lenteur et de sa brutalité (…) Mais il est trop tard. Cette loi du 3 octobre 1940 considère comme juive toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif. Elle interdit aux Juifs les métiers de la fonction publique.»
-
le recensement de tous les juifs et …. la clandestinité : « Deux frères mythologiques. Ephraim a toujours été travailleur, fidèle à son épouse, soucieux du bien commun. Emmanuel n’a jamais tenu ses promesses (…). En temps de paix, ce sont les Ephraim qui fondent un peuple – parce qu’ils font des enfants et qu’ils les élèvent avec amour, avec patience et intelligence (…) ils sont les garants d’un pays qui fonctionne. En temps de chaos, ce sont les Emmanuel qui sauvent le peuple – parce qu’ils ne se soumettent à aucune règle (…). »
-
la spoliation des biens et la longue marche de la déshumanisation…..
Au fil de ma lecture, j’ai assimilé de nouvelles méthodes de recherches, enrichi mon panel
 d’exploration au travers de documents insoupçonnés, sans rester « accrochée » à mon arbre et me priver d’autres pistes.
d’exploration au travers de documents insoupçonnés, sans rester « accrochée » à mon arbre et me priver d’autres pistes.Dieu que cette lecture fut difficile, mais tellement captivante !
Si l’on doit retenir une seule chose de livre, c’est que les « Les silences font toujours souffrir…. »
« - Pourquoi tu fais tout ça ? A quoi cela te sert ?
- Je n’en sais rien, maman, c’est une force qui me pousse. Comme si quelqu’un me demandait d’aller jusqu’au bout.
- Et bien moi j’en ai ras le bol de répondre à tes questions ! C’est mon passé ! Mon enfance ! Mes parents ! Tout cela n’a rien à voir avec toi. Et j’aimerais que tu passes à autre chose maintenant. »
Comme cette réplique me fait écho….
*
Pour en savoir plus :
L’arbre de Noemie (Geneanet)
L’arbre de Myriam (Geneanet)
Savez-vous ce qu'est une Datcha?
La liste Otto (Gallica)
Les Juifs de Lettonie - De l'oubli à la mémoire (Cairn)
Inauguration de l'exposition "Le Juif et la France " au Palais Berlitz (INA)
La rafle du billet vert (France24)

Les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande (Cercil – Musée mémorial des enfants du Vel d’hiv
Les déportations de France (Chemins de mémoire)
Retour au Lutetia (Les sanglots longs des violons)
Des femmes au service du Reich (Arte)
Un jour à Auschwitz (ARTE)
MORÉNAS François, Guilhem (Le Maitron)
Gabrielle Jeanine Picabia, chef du réseau Gloria SMH (Musée de la Résistance)
Réseau Gloria SMH : états des agents P2 (SHD)
Résistants du Vercors, des vies engagées
Anne Berest / prix et distinctions (Wikipedia)
 votre commentaire
votre commentaire
-
-
Par FANNOU93 le 26 Janvier 2023 à 12:23
 Fin des années 1860. Jeanne, une orpheline de 16 ans, s'enfuit de la ferme où sa belle-mère l'a placée. Arrivée à Port-Dieu, en Dordogne, elle est embauchée comme fille de cuisine par une aubergiste. Le jour où Florimond, photographe ambulant, débarque dans le village avec sa roulotte et sa jument, la jeune fille est fascinée par ce drôle de personnage. Malgré leur différence d'âge, une relation forte naît entre eux. L’aventure commence…. Dans la région de Clermont-Ferrand.
Fin des années 1860. Jeanne, une orpheline de 16 ans, s'enfuit de la ferme où sa belle-mère l'a placée. Arrivée à Port-Dieu, en Dordogne, elle est embauchée comme fille de cuisine par une aubergiste. Le jour où Florimond, photographe ambulant, débarque dans le village avec sa roulotte et sa jument, la jeune fille est fascinée par ce drôle de personnage. Malgré leur différence d'âge, une relation forte naît entre eux. L’aventure commence…. Dans la région de Clermont-Ferrand.Je dis toujours qu’il y a deux façons de lire un livre : soit se contenter de lire une histoire bien sympathique, ou bien de « creuser » un peu plus loin pour approfondir l’environnement, les personnages et vérifier la véracité des faits.
J’aurais pu me contenter de cette belle histoire entre une jeune femme qui chemine avec un photographe ambulant, sans me poser de questions ; pourquoi pas ! Mais voilà, je n’ai pu m’empêcher d’aller plus loin ; d’autant plus que l’auteur Jean-Guy SOUMY a reçu le prix d’Arverne 2022 pour ce superbe roman régional où il relate l’existence des photographes itinérants à la fin du XIXème siècle au travers des paysages auvergnats.
Le prix Arverne a été créé en 2007 à l'initiative de la Ligue auvergnate et du Massif Central ; il est destiné à récompenser une publication littéraire, soit écrite par une personne originaire de l'un des sept départements que représente la Ligue auvergnate et du Massif Central, à savoir : l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Haute-Loire, le Lot, la Lozère et le Puy-de-Dôme, l'Allier et la Creuse soit qui traite d'un sujet concernant l'Auvergne (Wikipedia).
Ce fut pour moi l’occasion d’allier deux passions : la photographie et la généalogie.
Jeanne découvre le métier de photographe ambulant, son savoir-faire, son savoir-être aussi, et le personnage que Florimond doit afficher pour être crédible :
« … lorsque je m’approche d’un village, je mets un chapeau sur ma tête pour inspirer confiance, faire croire que je suis un « monsieur ». Mais je ne suis qu’un photographe ambulant. Un homme sans attache. »
Elle apprend toutes les techniques, tout en restant concentrée, méthodique et très ordonnée ; elle qui était destinée à n’être qu’une simple fille de ferme, va se révéler :
«… Florimond entre dans la tente percée d’une lucarne jaune et recouvre une plaque de collodion humide. C’est une opération qui demande de l’habileté, la couche de collodion devant être homogène, sans amas et sans manques. Il plonge alors la glace dans un bain d’argent puis la place dans un châssis de bois. A partir de maintenant, le temps lui est compté. Avant que le collodion ne sèche, il doit prendre la photographie et retourner dans la tente pour y révéler et fixer le négatif apparu sur le verre. »
……………..
« Un scalpel, des entonnoirs, des éponges, une paire de pinces en corne. Sur le plancher, des caisses en bois pourvues de claies dans lesquelles sont stockées verticalement les plaques de verre. D’autres casiers, avec des trous pour maintenir droites des bouteilles étiquetées… Alcool, peroxyde, éther, iodure d’argent… pour le collodion. Et là, acide gallique, acide acétique, hyposulfite de soude pour la fixation de l’épreuve sur verre. Chlorure de sodium pour la préparation papier.»

Florimond est un artiste « magicien » ; il immortalise le regard de ceux qu’il emprisonne dans son boîtier photographique, tout en adéquation avec la lumière naturelle ; il nous initie aux temps de pause (très long pour l’époque), au choix du décor et de l’appareil ; il nous invite dans son atelier et nous familiarise avec les produits de son laboratoire. Il nous apprend la minutie, la rigueur et l’exactitude de son art, où l’approximation n’a pas sa place.
« …. replié la tente, rangé le matériel, les bacs, les bassines, les flacons, les bouteilles d’acide, les châssis, la toile de fond, les piquets, la corde…. »
Si ce roman aborde la vie d’un photographe ambulant, il aborde également la condition féminine au 19ème siècle, en passant par la syphilis (et la prostitution), l’environnement carcéral et les codes vestimentaires puisque Jeanne n’hésitera pas « porter la culotte » !
Ce livre est un réel dépaysement et un excellent moment de lecture…. Enrichissante !
Pour en savoir plus :
L'historique et l'évolution de l'art de la photo !
Manuel opératoire de photographie sur collodion instantané / par Disdéri,... (Gallica)
ALLOUEL Émile, Jacques, Étienne (Dictionnaire des imprimeurs-lithographes du 19ème siècle)
Loi de la presse sous le Second Empire et la Troisième République (Wikipedia)
Histoire de la syphilis : son origine, son expansion (Gallica)
Abrogation de l'interdiction du port du pantalon pour les femmes (Sénat)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par FANNOU93 le 23 Décembre 2022 à 19:26
 Juin 1944, le petit Mainou, neuf ans, vient de perdre sa mère, morte en couches. Son père décide de l'envoyer chez sa grand-mère, à la « Frohmühle » la ferme-épicerie familiale, située en Lorraine et par-delà la ligne de démarcation. Nous sommes au pays de Bitche.
Juin 1944, le petit Mainou, neuf ans, vient de perdre sa mère, morte en couches. Son père décide de l'envoyer chez sa grand-mère, à la « Frohmühle » la ferme-épicerie familiale, située en Lorraine et par-delà la ligne de démarcation. Nous sommes au pays de Bitche.Mainou va donc faire la connaissance de cette famille mosellane : découvrir avec l'oncle Émile le pouvoir de l'imagination, trouver la force de faire son deuil et de survivre dans une France occupée ; si sa grand-mère est la sagesse incarnée, frêle et forte à la fois, sa tante Louise recherche son courage dans la foi.
Mainou n’a pas grand-chose à faire, enfermé dans LA chambre de sa maman ; alors il va lui écrire, il va lui raconter avec ses mots et ses émotions d’enfant, son quotidien avec ses chagrins, ses angoisses, ses questionnements et sa curiosité….
« Le grand beau à regarder par la fenêtre, comme quand on est malade. Je m’efforce d’imaginer une balance pour équilibrer le positif et le négatif. »
Une curiosité qui va lui permettre de percer bien des secrets. « J’ai la sensation que tout est monté à l’envers depuis que tu es partie, comme si la nuit tu avais travaillé à remettre le monde en place. C’est à moi de le faire maintenant. Je ne sais pas trop comment ça marche, le monde. L’Émile dit que je dois commencer par essayer de faire fonctionner le mien.

- Le seul jouet sur lequel tu peux compter, c’est ton cerveau ! Fouille sous la colère ce qu’il reste de joie et rééduque ton rire. »
Son oncle Émile va l’aider à trouver le temps un peu moins long en s’occupant de son éducation : « désobéir tout le temps, c’est à peu près aussi stupide que d’obéir tout le temps, mais ça a le mérite d’être un tout petit peu plus divertissant. Regarde ces abrutis de nazis, on en est là parce qu’ils sont tous partis du principe qu’il fallait obéir sans réfléchir. »
Mainou se pose beaucoup de questions : faut-il être un rêveur comme oncle Emile et « oublier que quand on rêve trop grand, on passe sa vie à être déçu de la réalité » ou bien rêver comme tante Louise et « oublier que quand on ne rêve pas ses propres rêves, on s’emmerde ».
 Le temps passe : entre la chambre de sa mère et la cave où il se met à l’abri des bombardements. Au fil du temps, Mainou grandit ; ses quelques mois de guerre l’ont vu mûrir : « A force de t’écrire, j’ai construit tout un monde où je te retrouve. (…) C’est une forme de magie artisanale, comme faire pousser des trucs dans le jardin. Le jardin, c’est moi. L’eau, c’est l’Emile... »
Le temps passe : entre la chambre de sa mère et la cave où il se met à l’abri des bombardements. Au fil du temps, Mainou grandit ; ses quelques mois de guerre l’ont vu mûrir : « A force de t’écrire, j’ai construit tout un monde où je te retrouve. (…) C’est une forme de magie artisanale, comme faire pousser des trucs dans le jardin. Le jardin, c’est moi. L’eau, c’est l’Emile... »L’écriture, la poésie vont permettre à Mainou de surmonter ce violent séisme que sont la perte de sa mère et la réalité de l'Occupation. Mais l’enfant s’en sortira grandi, car « l’amour ça s’entretient comme un potager. Et la poésie, c’est le meilleur des engrais. »
Le « petit Mainou » est le père de l’auteur ; il aura fallu plus de six ans à Mathias MALZIEU pour écrire ce récit, un roman intime, où se mêlent humour, tendresse et poésie. Si certains passages font sourire, d’autres en revanche mettent les larmes aux yeux. C’est un livre très émouvant, un livre écrit avec des tripes…. C’est un bel hommage à son « merveilleux papa » et à toute sa famille.
Souvenez-vous : on ne dit jamais assez que nous aimons ; le temps passe, s’accélère… et si la pudeur vous retient, écrivez…..
*
Mathias MALZIEU est un musicien, chanteur, écrivain, scénariste et réalisateur français, né le 16 avril 1974 à Montpellier. Il est le chanteur du groupe de rock français Dionysos. Une petite pépite !
*
Pour en savoir plus :
Mathias Malzieu, Le Guerrier de porcelaine : histoire de la création du livre
Mathias Malzieu, Le Guerrier de porcelaine : un père héros et lecteur
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par FANNOU93 le 17 Décembre 2022 à 18:13
Des abandons d’enfant au XIXe siècle aux accouchements sous X aujourd’hui, quel est le rôle de la contrainte économique dans le choix de vivre sans enfant ?
À Paris, entre la fin du XIXe et le milieu du XXe siècle, près des trois quarts des femmes qui abandonnent un enfant sont domestiques ou ouvrières. Avant la diffusion et la légalisation des moyens de contraception et d’avortement, la décision de ne pas garder son enfant est très souvent dictée par la contrainte économique. (cliquez sur l'image)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par FANNOU93 le 14 Décembre 2022 à 19:33
 Rosa SAUER est née le 27 décembre 1917, son père était cheminot et sa mère couturière ; nous sommes en 1943. Berlin, capitale du IIIème Reich, est bombardée et Rosa perd ses parents ; elle se réfugie alors chez ses beaux-parents, à Gross-Partsch, son mari Gregor s'étant engagé dans l'armée allemande.
Rosa SAUER est née le 27 décembre 1917, son père était cheminot et sa mère couturière ; nous sommes en 1943. Berlin, capitale du IIIème Reich, est bombardée et Rosa perd ses parents ; elle se réfugie alors chez ses beaux-parents, à Gross-Partsch, son mari Gregor s'étant engagé dans l'armée allemande. Gross-Partsch est un village situé en Prusse orientale, où est installé le Quartier général d'Hitler. Reclus dans « la tanière du loup » et terrorisé à l’idée que l’on attente à sa vie, Hitler a fait recruter des goûteuses. Parmi elles, Rosa.
Rosa ne peut rien faire d'autre que de suivre les SS venus la chercher pour l'emmener à la caserne Krausendorf. Et lorsqu’ils lui ordonnent de porter une cuillerée à sa bouche, elle s’exécute, la peur au ventre : chaque bouchée est peut-être la dernière. On ne s’oppose pas aux directives de la Gestapo. Toutes les « goûteuses » doivent tester la nourriture destinée au dictateur. La réalité est la même pour toutes : consentir à leur rôle, c’est à la fois vouloir survivre et accepter l’idée de mourir.

Mais Rosa doit affronter une autre guerre entre les murs de ce réfectoire : considérée comme « l’étrangère », « la Berlinoise », Rosa doit affronter l’hostilité de ses compagnes, dont Elfriede, une personnalité aussi charismatique qu’autoritaire.
« Pourquoi, depuis un certain temps, me retrouvais-je dans de endroits où je ne voulais pas être et l’acceptais-je sans me rebeller, pourquoi continuais-je à survivre chaque fois que quelqu’un m’était enlevé ? La capacité d’adaptation est la principale ressource des êtres humains, mais plus je m’adaptais et moins je me sentais humaine. »
Au fil des jours, une certaine routine s’installe ; les goûteuses se surprennent à aimer la Griesnockerlsuppe (image 1) aux petits gnocchis de semoule, l’Eintopf (soupe de légumes), sans porc ni veau, le Schnecke à la canelle (image 2) ou bien le Strudel (image 3) aux graines de pavot.
Des amitiés naissent, des rancœurs et des jalousies aussi, des complicités entre femmes embrigadées dans la même galère et puis la révélation de secrets que chacune cache.
Car toutes ont un secret, même Rosa. Il s’appelle Albert Ziegler, : « Ziegler ou un autre, ça aurait été pareil, voilà ce que je pensais. J’ai fait l’amour avec lui, parce que je ne l’avais pas fait depuis trop longtemps. » Tombée sous l’emprise de « l’Obersturmführer » de la tanière du loup, elle ne s’en remettra jamais.
« Sans cordination, aveugles, nous guidant à l’odorat, nous trébuchâmes dans le corps de l’autre comme si chacun mesurait le sien pour la première fois.
Après, aucun des deux ne stipula que personne ne devait savoir, mais chacun se comporta comme si nous avions passé un pacte. Nous étions mariés l’un et l’autre, même si désormais j’étais seule. Il était lieutenant ds SS : que se passerait-i si on découvrait qu’il avait une relation avec une goûteuse ? Peut-être rien. Peut-être était-ce interdit. »
Ce roman historique a été inspiré de l’histoire de Margot WOLK ; j’ai beaucoup aimé ce livre où se mêlent amours, craintes, doutes, peurs, et interrogations. Ce récit permet un éclairage sur une Allemagne que l’on a trop souvent qualifiée de « nazie » alors que de nombreux allemands ont subi la violence d’un dictateur fou et à l’orgueil excessif. J’ai notamment appris qu’Hitler était « végétarien »…. Info ou intox ? Quoiqu’il en soit, la propagande était telle que le Führer se devait de montrer l’exemple auprès d’un peuple qui ne mangeait plus à sa faim….Et que penser de l’Obersturmführer Ziegler transis d’amour pour une goûteuse, mêlant violences et tendresse, rigueur et obéissance : je crois que l’auteure s’est accordée quelques petits arrangements avec l’Histoire. Mais ce n’est pas bien grave…..
Pour ce prestigieux roman, la contemporaine italienne Rosella Postorino a été récompensé par le prix Camiello.
Pour en savoir plus :
Wolfsschanze ou la « Tanière du Loup » (Wikipedia)
Les bouchées de la terreur – L’histoire de Margot Woelk, goûteuse d’Hitler
"La Goûteuse d'Hitler" de Rosella Postorino, c'est "le point Godwin de la littérature" !
Recette d’un Schnecke aux pépites de chocolat
Recette de l’Apfelstrudel
Claus von Stauffenberg, ce comploteur qui voulait tuer Hitler (Geo)
La gouteuse d’Hitler – Margot Woelk
Les dernières heures d'Hitler | Archives inédites
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par FANNOU93 le 4 Décembre 2022 à 14:54
 Quatrième de couverture : « Laurence Barraqué grandit avec sa sœur dans les années 1960 à Rouen.
Quatrième de couverture : « Laurence Barraqué grandit avec sa sœur dans les années 1960 à Rouen.
"Vous avez des enfants? demande-t-on à son père. – Non, j’ai deux filles", répond-il.Naître garçon aurait sans doute facilité les choses. Un garçon, c’est toujours mieux qu’une garce. Puis Laurence devient mère dans les années 1990. Être une fille, avoir une fille : comment faire ? Que transmettre ?
L’écriture de Camille Laurens atteint ici une maîtrise exceptionnelle qui restitue les mouvements intimes au sein des mutations sociales et met en lumière l’importance des mots dans la construction d’une vie.»Etre une fille ou une femme, comme dirait Gisèle Halimi, c’est une malédiction, et nous ne sommes pas en Tunisie – pays natal de l’avocate – mais bien en France !
Ce livre pourrait être une banale histoire de femme désireuse de sortir de la condition dans laquelle sa famille veut l’enfermer, mais dès le début, on découvre l’univers de Laurence : un père médecin, patriarche et mandarin, une mère au foyer, soumise et effacée et une sœur aînée Claude, au prénom épicène, c’est-à-dire non genré, qui la traite aussi mal que le « paternel ». De l'enfance à sa condition de mère, elle décline tous les épisodes qui marquent l'évolution d'un destin ordinaire mais aussi du regard de la société sur le statut de la femme, en détaillant les conditions dictés par le langage : en somme, une existence de femme et autant d'étapes cruciales où chacune d’entre nous peut y retrouver des similitudes : déceptions amoureuses, agressions sexuelles, perte d'un enfant.

Camille LAURENS pointe du doigt des anomalies que l'on ne relèverait pas, tant l'habitude et les automatismes nous en cachent le sens profond : comme par exemple, le père va le matin à la mairie déclarer la naissance, la « née-sans ». L’auteure joue sans cesse avec les mots et les associations d’idées, parfois très surprenantes.
On plonge dans l’univers d’un machiste, une société conservatrice où le devenir d’une jeune fille est d’être une bonne épouse, serviable, méritante, sachant bien tenir son foyer. On peut se demander comment Laurence pourra se construire dans ce cercle familial si « arriéré » où la règle d’or est de « laver son linge sale en famille »…..
Les féministes seront révoltées à la lecture de ce livre, mais n’est-ce pas le but ? Réfléchir et s’insurger pour mieux avancer….
Mesdames, avez-vous conscience que nous sommes un gros caillou dans la chaussure de certains messieurs…?!
Pour en savoir plus :
« Fille » de Camille Laurens : c’est quoi être une femme ?
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par FANNOU93 le 4 Décembre 2022 à 13:48
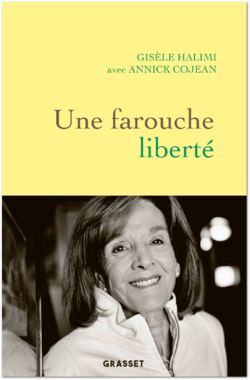 Quatrième de couverture : « Soixante-dix ans de combats. Soixante-dix ans de passion et d’engagement au service de la justice et de la cause des femmes. Et toujours, la volonté de transmettre aux nouvelles générations le flambeau de la révolte. Parce que l’égalité entre homes et femmes est loin d’être acquise. Et parce que naître femme reste une malédiction dans la plupart des pays du monde.
Quatrième de couverture : « Soixante-dix ans de combats. Soixante-dix ans de passion et d’engagement au service de la justice et de la cause des femmes. Et toujours, la volonté de transmettre aux nouvelles générations le flambeau de la révolte. Parce que l’égalité entre homes et femmes est loin d’être acquise. Et parce que naître femme reste une malédiction dans la plupart des pays du monde.Avec son amie Annick Cojean, l’avocate la plus célèbre de France revient sur les épidodes marquants de son parcours rebelle. Son enfance en Tunisie dans une famille juive modeste ; son refus d'un destin assigné par son genre et son rêve de devenir avocate ; sa défense indéfectible des militants des indépendances tunisienne et algérienne soumis à la torture ; son association « Choisir la cause des femmes » ; et, bien sûr, ses grands combats pour l'avortement, la répression du viol, la parité.
La dernière grande héroïne féministe aura vécu une vie de pionnière, insoumise et passionnée. D’une farouche liberté. »
Gisèle Halimi, c’est une vie de combats, de passion et d'engagement au service de la justice et par dessus tout, de la cause des femmes. Et jusqu'à son dernier souffle, une volonté intacte de transmettre aux nouvelles générations le flambeau de la révolte.
« L’injustice m’est physiquement intolérable. Je l’ai lancé un jour à la tête d’un magistrat qui a été choqué par ma véhémence.
Mais c’était un cri du cœur, presque un cri de douleur. La rage que je ressentais remontait à très loin. Injustice de naître fille, injustice de naître pauvre, injustice d’un destin assigné par ma condition ».
« Gisèle Halimi (1927-2020) est née en Tunisie d'une mère juive, Fortunée Metoudi ("heureux" en
 arabe) et d'un père d'origine berbère, Édouard Taïeb ("bienfaisant" en arabe). En 1949, elle épouse Paul Halimi, administrateur civil au ministère français de l’Agriculture. Avocate et militante elle fut à la pointe du combat féministe des années 1960 et 1970 qu'elle a souvent incarné avec une conviction profonde.
arabe) et d'un père d'origine berbère, Édouard Taïeb ("bienfaisant" en arabe). En 1949, elle épouse Paul Halimi, administrateur civil au ministère français de l’Agriculture. Avocate et militante elle fut à la pointe du combat féministe des années 1960 et 1970 qu'elle a souvent incarné avec une conviction profonde.Le nom de famille Halimi, 520 foyers en France (Ile-de-France, Provence, Rhône-Alpes), est originaire du Maghreb (Tunisie, Alger, Constantine). Son origine se situe dans un nom arabe qui signifie "doué de sagacité". Il se retrouve également sous les formes Alemy, Alimi, Allimi, Hlimi, etc. » (RFG)
Éprise de littérature française et notamment de V. HUGO « ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ; ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l’âme et le front... » elle côtoie Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, François Mitterand – plus tout à faire l’Homme de Gauche qu’il laissait entrevoir – Aragon et Elsa Triolet, Poirot-Delpech, Barbara, Piaf, Aimé Césaire, Guy Bedos et tant d’autres….. Elle était une écrivaine et une avocate, une femme, engagée. « Ne vous résignez jamais ! » ne cessera t-elle jamais de dire. Parce qu’au crépuscule de sa vie, elle attend que les femmes « fassent la révolution ».
« Il faut une révolution des mœurs, des esprits, des mentalités. (…) Pendant longtemps la soi-disant incompétence des femmes a servi à justifier leur exclusion des lieux de pouvoir et de responsabilité. Forcément une femme instruite est réputée dangereuse, on s’arrangeait pour les priver d’instruction ou d’accès aux meilleures écoles. »
Pour en savoir plus :
Qui était Gisèle Halimi ? | Archive INA
#TBT : en 1977, le combat de Gisèle Halimi pour criminaliser le viol
1989 : Gisèle Halimi s'oppose au voile islamiste | Archive INA
Gisèle Halimi (Podcasts RadioFRance)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par FANNOU93 le 7 Novembre 2022 à 09:39
« Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle l’attaque contre l’ennemi allemand. Les soldats s’élancent. Dans leurs rangs, Alfa Ndiaye et Mademba Diop, deux tirailleurs sénégalais parmi tous ceux qui se battent sous le drapeau français. Quelques mètres après avoir jailli de la tranchée, Mademba tombe, blessé à mort, sous les yeux d’Alfa, son ami d’enfance, son plus que frère. Alfa se retrouve seul dans la folie du grand massacre, sa raison s’enfuit. Lui, le paysan d’Afrique, va distribuer la mort sur cette terre sans nom. Détaché de tout, y compris de lui-même, il répand sa propre violence, sème l’effroi. Au point d’effrayer ses camarades. Son évacuation à l’Arrière est le prélude à une remémoration de son passé en Afrique, tout un monde à la fois perdu et ressuscité dont la convocation fait figure d’ultime et splendide résistance à la première boucherie de l’ère moderne ».
Dans l’enfer des tranchées. Il y a Alfa, les Chocolats et les Toubabs, et puis Mademba, son ami d’enfance, « son presque frère ».
Alfa et Mademba sont deux tirailleurs sénégalais partis loin de Gandiol, leur village natal. Et ils sont fiers…
« quand ils surgissent de la tranchée leur fusil dans la main gauche et le coupe-coupe dans la main droite, en se projetant hors du ventre de la terre, ils posent sur leur visage des yeux de fous. »
Mais Mademba, « son plus que frère » tombe, éventré avec le « dedans du corps dehors », qui n'en finit plus d'agoniser dans ses bras, les tripes à l’air, mais qui ne peut se résoudre à abréger ses terribles souffrances. Alfa ne s’en remettra jamais, hanté par la culpabilité de n'avoir pas su accompagner et aider « son plus que frère ».

Alfa se retrouve donc seul dans cette boucherie. La folie s’empare de lui et il s’autorise enfin à penser :
« Depuis que j’ai décidé de penser par moi-même, je ne peux rien m’interdire en matière de pensée, j’ai compris que ce n’est pas l’ennemi d’en face aux yeux bleus qui a tué Mademba. C’est moi. »
Ce roman dénonce l’horreur de la Guerre : mais qui est le plus fou ? Alfa le fou mutilant ou le coup de sifflet du capitaine Armand qui expédie ses soldats sous les obus ennemies ?
Ce monologue – un cri dirai-je - oscille entre le dégoût et la poésie ; le style est surprenant, tantôt fait de phrases répétitives comme une oraison funèbre, tantôt sublime lorsqu’Alfa parle de son pays.
 Ce livre fut pour moi l’occasion de faire des recherches sur les Sénégalais de cette terrible période, enrôlés de force pour la plupart dans une guerre qui ne les concernait pas.
Ce livre fut pour moi l’occasion de faire des recherches sur les Sénégalais de cette terrible période, enrôlés de force pour la plupart dans une guerre qui ne les concernait pas.Pour en savoir plus :
L'histoire des tirailleurs sénégalais
Les tirailleurs sénégalais (Sénégal On Line)
Le sacrifice des tirailleurs sénégalais sur le Chemin des Dames
La France et les tirailleurs: une histoire mouvementée
Les tirailleurs sénégalais dans la Grande Guerre et la codification d'un racisme ordinaire
Liste des tirailleurs sénégalais décédés pendant la Deuxième Guerre Mondiale
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par FANNOU93 le 6 Novembre 2022 à 14:06
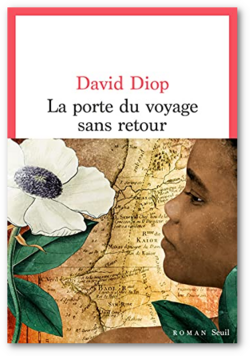 « La porte du voyage sans retour » est le surnom donné à l’île de Gorée, d’où sont partis des millions d’Africains au temps de la traite négrière.
« La porte du voyage sans retour » est le surnom donné à l’île de Gorée, d’où sont partis des millions d’Africains au temps de la traite négrière.L’auteur David DIOP, né le 24 février 1966 à Paris, a passé une partie de sa jeunesse au Sénégal ; il est un enseignant-chercheur et écrivain français.
Spécialiste de littérature du XVIIIe siècle, il est lauréat du prix Goncourt des lycéens en 2018 et du prix international Man-Booker en 2021 pour son roman Frère d'âme.
1750, au Sénégal et plus précisément le long de la côte atlantique de Saint-Louis jusqu’à l’Ile de Gorée.
Cette fiction est inspirée et centrée sur la personnalité du naturaliste Michel Adanson (1727-1806), et tout particulièrement sur un épisode de sa vie ; au décès de son père, Aglaé découvre un épisode extraordinaire de la vie du botaniste au Sénégal, dans des carnets cachés au fond d’un tiroir secret.
Le talent de conteur de David DIOP nous embarque au pays des wolofs où le naturaliste voulait « rencontrer des plantes, mais a découvert des hommes » et leurs souffrances.
Venu au Sénégal pour étudier la flore locale tout en caressant le rêve d’établir une encyclopédie universelle du vivant, il se laisse envoûter par le « fantôme » bien réel d'une jeune Africaine Maram
 promise à l'esclavage, pour finalement faire basculer cette quête amoureuse en une révolte contre le sort réservé aux Noirs.
promise à l'esclavage, pour finalement faire basculer cette quête amoureuse en une révolte contre le sort réservé aux Noirs.Le naturaliste est si subjugué par ce pays qu’il juge utile d'apprendre la langue wolof pour échanger avec les locaux : « la langue wolof, parlée par les Nègres du Sénégal, vaut bien la nôtre. Ils y entassent tous les trésors de leur humanité : la croyance dans l’hospitalité, la fraternité, leurs poésies, leur histoire, leur connaissance des plantes, leurs proverbes et leur philosophie du monde ».
Les personnages sont ensorcelants : tant la belle Maram, guérisseuse africaine, incarnation d’une beauté exotique et victime des plus bas instincts masculins, que le jeune Ndiak, fidèle guide et compagnon d’Adanson. Mais que dire d’Estoupan de la Brüe, le Directeur générale de la Concession, pourvoyeur d’esclaves raflés lors du « moyal », cette razzia pratiquée par des guerriers mercenaires contre leurs frères noirs.
Il n’aura de cesse de découvrir la nature de l’homme blanc au travers d’un abolitionnisme acharné, réalisant que la supposée infériorité des « Nègres » n'est qu'un leurre pour légitimer leur traite.
Sous le couvert d’une impossible histoire d’amour, au cœur d’un pays paré de fantastique, de folklore et de coutumes, ce livre est une « mise à nu » sans pudeur d’un père pour sa fille, qu’il a délaissé, obsédé d’écrire sa grande œuvre encyclopédique ; mais c’est surtout la terrible
 dénonciation de l’esclavage au Sénégal que l’auteur veut transmettre.
dénonciation de l’esclavage au Sénégal que l’auteur veut transmettre.A la manière d’un Candide moderne, David DIOP nous sensibilise à la traite négrière et incite au devoir de mémoire. D’ailleurs, le naturaliste Michel Adanson ne se relèvera jamais de cette découverte :
« Si j’en avais eu le loisir et l’envie (…) j’aurai alors ajouté à mon petit exposé agricole que les milliers de Nègres que la Concession du Sénégal envoyait aux Amériques auraient été mieux employés à cultiver les terres arables d’Afrique (…). Mon idée était en effet incompatible avec la richesse d’un monde qui roulait sur la traite de millions de Nègres depuis plus d’un siècle. Il fallait donc que nous continuions à manger du sucre imprégné de leur sang. Les Nègres n’avaient pas tort qui croyaient (…) que nous les déportions aux Amériques pour les y dévorer comme du bétail. »
Pour en savoir plus :
Membres de l'Académie des sciences depuis sa création (Institut de France)
Visiter l’île de Gorée au Sénégal
L’ile de Gorée (Sénégal on Line)
Zoom sur l’île de Gorée : escale avant l’Amérique
Retrouver ses ancêtres au Sénégal (Geneanet)
Les archives nationales d’Outre Mer (ONAM)
Les populations d’Afrique Subsaharienne (Geneafinder)
Généalogie dans les DROM-COM et anciennes colonies (Geneafinder)
Sénégal Ile de Gorée Maison aux esclaves (Hors frontières)
Film: "L' île de Gorée AFRICA, l'Histoire des esclaves sans retour."
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique